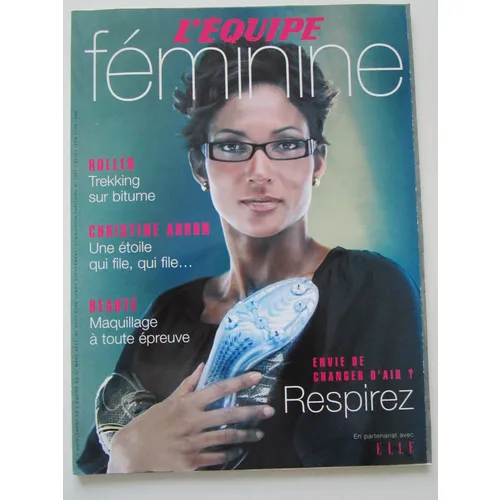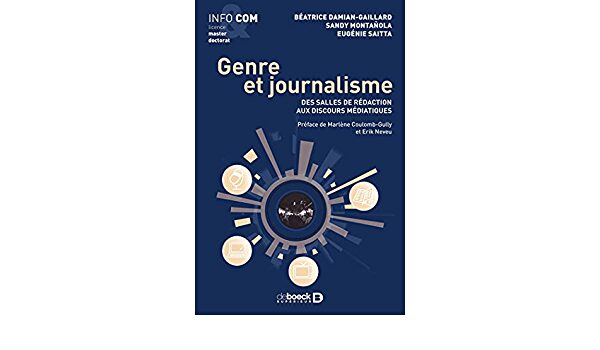Est-ce que l’apparition du sport féminin dans les médias, en France, est un phénomène que l’on peut dater ?
Oui, nous avons des dates précises, mais par types d’épreuves et de sport. On considère, d’un point de vue général, que les premiers articles en la matière vont plutôt concerner le football et, qui plus est, des compétitions internationales auxquelles les équipes françaises ne participent pas forcément.
Il reste qu’il est compliqué d’établir une chronologie car, en fonction des époques, le contexte diffère et la médiatisation évolue. J’ai, pour ma part, travaillé sur la médiatisation des Jeux Olympiques entre 1952 et 2004.
En 1952, il n’y avait pas de rubrique olympique dédiée et on parlait, par exemple, de natation et de l’équipe de France sans distinction. Aujourd’hui, on s’est habitué à faire des articles séparés et on traite, d’un côté, le sport masculin et de l’autre, le sport féminin.

JO 1952, le podium du 200m féminin remporté par l’Australienne Marjorie Jackson…©Wikipedia
En France, la naissance du sport féminin remonte au début des années 10. Le journal l’Auto, l’ancêtre de l’Équipe, le mentionne pour la première fois en bandeau de Une, sous le titre, dès le 23 juin 1921. Peut-on parler d’un début de reconnaissance médiatique pour les sportives ?
Il y a de la médiatisation pour le sport féminin dès le début du 20e siècle. On va en trouver en Une sans que ce dernier ne s’impose forcément.
Le sport féminin est traité à titre d’exception et c’est un phénomène courant. J’ai travaillé sur la boxe féminine et j’ai retrouvé la même chose.
En 2005, pour la première fois, les femmes ont pu faire des championnats du monde pro avant d’être intégrées aux Jeux Olympiques en 2012. Canal+ retransmettait les Mondiaux et il y avait une championne du monde française, Myriam Lamare, ce qui a fait que, à cette occasion, il y a eu pas mal d’articles sur le sujet.
On a pu avoir l’impression, de fait, qu’il y avait une médiatisation croissante de la boxe féminine, une forme de reconnaissance de cette discipline mais pas du tout. Passé ces évènements, on n’a quasiment plus parlé de boxe féminine.

La boxeuse, Myriam Lamare
Il est vrai qu’en ce qui concerne l’Auto, le sport féminin est mentionné en bout de course, après le football, le rugby… comme s’il fallait spécifier que l’on parlait, avant tout, de vrais sports renvoyant par là la pratique féminin à un objet à part.
C’est un phénomène qui a été observé en recherche et qui vaut pour tous les secteurs. Quand un domaine, traditionnellement masculin s’ouvre aux femmes, il se passe toujours la même chose : on fait une distinction entre hommes et femmes avec cette idée que ça devrait rester un domaine masculin.
En somme, on ouvre ces pratiques à condition d’en faire quelque chose à part et on emploie le terme féminin pour montrer que les femmes ne vont pas le faire de la même façon.
L’idée d’asseoir une légitimité des championnes à travers les médias est donc une démarche utopique ?
Prenons l’exemple des Championnats du monde football « féminins ». À cette occasion, plusieurs médias ont décidé de traiter du football féminin et de parler de Mondial masculin ou féminin. Mais distinguer les deux revient à dire que ce sont deux sports différents.
Ils ne sont pas mis au même niveau et cela implique qu’il n’y a pas la même reconnaissance. Tout cela s’inscrit dans un écosystème complexe dans lequel entrent en compte des considérations économiques, de visibilité, d’audience.
Pour reprendre l’exemple des Jeux Olympiques, en 1952, on parlait d’équipe de France et puis, au fur et à mesure, on a individualisé la médiatisation, c’est-à-dire que l’on a commencé à parler plus des joueurs que de l’équipe elle-même.
Ce faisant, on a également commencé à distinguer le sport féminin du sport masculin. On aurait pu imaginer un traitement plus équilibré mais ça ne l’a pas été pour une raison simple : il n’y a pas, d’un côté, le sport masculin et, de l’autre le sport féminin. Il y a, d’un côté, le sport générique, qui est masculin, et pour ce qui est des femmes, on précise.
Il y a pourtant eu des tentatives de presse spécialisée consacrée aux femmes sportives. On pense à Femina sport ou Sportives, dans la première moitié du 20e siècle ou, plus récemment, Olympe et l’Équipe féminine. Ces journaux n’ont pas connu le succès, est-ce que cela signifie qu’il n’y a pas public pour ce type de presse ?
L’Équipe féminine est un très bon exemple. À un moment donné, l’Équipe décide se lancer et de viser le lectorat féminin parce qu’il y a un marché.
Le problème, c’est qu’ils ont fait un partenariat avec le magazine Elle qui n’est pas du tout spécialisé en sport. Elle a fait le chemin de fer avec des rubriques santé, beauté, cuisine, des rubriques extrêmement stéréotypées dans lesquelles on expliquait, par exemple, comment faire du sport tout en restant bien coiffée.
Ces rubriques devaient être tenues par des journalistes de l’Équipe habituées, pour leur part, à écrire sur le sport. Pourquoi on ne trouve pas de public féminin dans ce cas-ci ? Parce que les femmes intéressées par le sport ne veulent pas ces rubriques-là.
L’idée, à la base, était, pour les femmes qui aiment le sport, de pouvoir lire du sport féminin dans l’Équipe et non pas d’en faire un support à part. Le positionnement éditorial était un peu antagoniste et les femmes qui lisaient ce journal ne s’y retrouvaient pas.

L’Équipe féminine, en 2007
À vous écouter, on a l’impression qu’il n’y a que deux alternatives pour le sport féminin : soit être traité dans une presse à dominante masculine, ce qui lui laisse peu de place, soit être traité dans une presse spécialisée qui ne donne pas, non plus, satisfaction.
Peu à peu, on va voir apparaître des médias plus alternatifs qui vont travailler sur la question du sport pratiqué par les femmes et, ça, sans recourir aux stéréotypes.
L’avantage, c’est que ça permet la monstration, ça permet de visibiliser les sportives et elles vont trouver, grâce à cela, une place dans un espace médiatique majoritairement occupé par les hommes.
Historiquement, c’est une récurrente pour les femmes. Elles ont toujours été contraintes de faire entendre leurs voix dans des espaces qu’elles sont obligées de créer elles-mêmes.
La constante de ces médias, c’est qu’ils sont, en général, peu rentables. Les femmes qui les tiennent le font le plus souvent sur la base du bénévolat, motivées par des revendications politiques ou féministes. Ça pose encore et toujours la même question : dans l’espace public et médiatique, les secteurs qui sont les plus légitimes et valorisés en nombre de ventes, de vues… sont toujours réservés aux hommes.
Ces médias viennent compenser un peu cette disproportion, mais ça pose problème car les femmes sont traitées dans des médias moins vus, moins lus.
Outre le public, il y a aussi la question des sportives. On s’aperçoit souvent que, même si elles ont des espaces dédiés, la vraie validation reste un article dans l’Équipe…
Tant que ces médias féminins ne seront pas autant reconnus que des médias jugés, pour le moment, plus légitimes, les sportives vont se tourner vers ces derniers. C’est normal, car ces femmes font face, elles-mêmes, à des difficultés en terme de reconnaissance sportive.
C’est une fois qu’elles l’ont, qu’elles se tournent vers les médias féminins. On peut se dire que c’est dommage, de leur part, de ne pas faire l’effort, mais on sait qu’il y a un coût assez important au fait d’être étiquetée ou « soupçonnée » d’être féministe, ce qui explique parfois les réticentes à aller vers ces supports.
Quelles incidences ont eu la radio et la télévision sur l’importance du traitement réservé aux femmes sportives dans les médias ?
La télévision est soumise à des problématiques d’audience, ce qui a contribué à réduire le nombre de sports médiatisés. Même dans le cas de la télévision publique, tout ce qui n’est pas rentable est amené à disparaître des chaînes.
Les droits télé ont également changé la donne. Il faut désormais aller sur telle ou telle chaîne pour suivre tel sport ce qui nécessite plusieurs abonnements. Avant, un sport qui passait à la télévision était accessible au plus grand nombre, son image était visible.
Avec l’apparition des droits télé, ce sport va être diffusé sur une chaîne beaucoup plus confidentielle et il y a moins de personnes qui vont le suivre. Il y a une vraie perte de visibilité pour les athlètes.
Ceci étant, l’exposition médiatique à la télévision a fait connaître des sportifs et il y a eu une vraie évolution quantitative. En revanche, cela a contribué à sexualiser les athlètes.
Pour résumer, on va avoir une visibilité médiatique relativement forte des athlètes en fonction de leurs critères physiques avec des plans choisis pour valoriser les physiques des sportives.

Les athlètes masculins échappent à ce phénomène ?
Il y a aussi une sexualisation du sportif, mais elle ne se fait pas de la même façon. Chez les sportifs, on sous-entend que, parce qu’ils sont sportifs, ils sont en forme et donc sexuellement performant. Ça a aussi un coût pour les premiers concernés et on le voit notamment quand il s’agit de revendiquer son homosexualité.
Pour les femmes, cette sexualisation passe plutôt par la valorisation de leur physique, les remarques sur leurs tenues. Avant on le faisait en politique, on le fait maintenant en sport parce qu’on se dit que ça s’appuie sur le corps.
Il y a aussi, chez les femmes, une infantilisation que l’on trouve très peu chez les hommes. On ramène toujours les femmes à un entraîneur, elles sont les filles de… On les ramène à des tutelles masculines, on les compare aux hommes pour dire qu’elles y arrivent bien…
L’idée est toujours la même, le sport masculin est l’étalon de mesure et le sport féminin vise à y ressembler, c’est du moins comme cela que c’est présenté.

Le manuel « Genre et Journalisme » auquel a participé Sandy Montanola, analyse les mécanismes de discriminations à l’œuvre dans le journalisme et fait la synthèse des travaux récents.
Le panorama n’est pas très engageant et pourtant il y a des preuves, statistiques notamment, qu’il existe un public pour le sport féminin. Est-ce que, finalement, les responsables des médias concernés ne présagent pas de ce que le public veut voir dans leurs émissions, leurs colonnes ?
Nier qu’il puisse y avoir un intérêt médiatique pour les femmes sportives est un argument utilisé pour ne pas les mettre en avant or, il n’a jamais été démontré que ça n’intéressait pas. Les sports qui ont été bien médiatisés ont, en général, rencontré leur public.
Pendant le mondial de football féminin, les journalistes qui nous interrogeaient nous demandaient si on pensait que le rendez-vous allait être suivi. C’était la grande interrogation, mais cette question ne se serait jamais posée pour un Mondial masculin.
Par la suite, le succès étant au rendez-vous, les journalistes se sont posés la question de savoir si la situation globale allait évoluer. En fait, ça ne va rien faire évoluer du tout car le problème n’est pas de savoir s’il y a un public ou pas mais de savoir ce que l’on va faire ensuite, de capitaliser là-dessus ou pas, de donner des moyens ou pas.
Pendant longtemps, on disait que le football féminin était pénible à regarder. Oui, c’était pénible à regarder parce que ce n’était pas filmé de la même façon que les matches masculins. Quand on n’a pas les mêmes moyens, on ne peut pas faire de ralentis, le temps de jeu paraît plus long. On compare deux choses qui n’ont rien à voir.
Est-ce que l’arrivée d’internet, et notamment des réseaux sociaux, a permis de mieux partager l’espace médiatique ?
Je n’ai pas beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux mais, par rapport aux derniers programmes de recherches qui ont été menés, on voit qu’il y deux discours parallèles qui se développent.
D’un côté, les réseaux permettent de prendre position. Quand il y a une victoire de l’équipe de France féminine de hand et que l’Équipe ne l’aborde pas, par exemple, il va y avoir des relais de sportives, de personnalités, hommes et femmes, évoluant dans le milieu pour dire que ce n’est plus acceptable.
De l’autre côté, le sport étant une économie, certaines sportives vont se servir des réseaux pour valoriser leur image et trouver des sponsors afin de pouvoir vivre de leur sport. On retrouve alors là tous les stéréotypes combattus par d’autres.
Je pense que les réseaux sociaux représentent une pression supplémentaire sur les femmes sportives.

Orlane Kanor lors de l’Euro de handball 2022… ©FFH
Est-ce qu’il y a des moyens, malgré tout, d’être optimiste quant à l’avenir de la médiatisation du sport féminin ?
Nous vivons une période particulière. On entend des discours très forts, y compris chez les étudiants journalistes qui ont une conscience aiguisée des inégalités et qui vont eux-mêmes travailler pour un traitement plus équitable.
Ce fonctionnement montre qu’il y a une vraie ouverture mais, comme à chaque période d’avancée sur les inégalités, il y a un retour de bâton avec des résistances très fortes et très violentes.
On a eu beau avoir l’impression d’une progression, on voit que c’est extrêmement fragile. Dès qu’il y a des enjeux financiers, les équipes qui vont passer en premier sont les équipes masculines.
Et on revient alors à des arguments que l’on entendait déjà dans les années 70 – la biologisation – à savoir que les femmes n’ont pas le même niveau que les hommes et donc qu’il est normal qu’elles ne soient pas payées pareil…
On a parfois l’impression d’un éternel recommencement.
D'autres épisodes de "Dans les coulisses du sport au féminin"