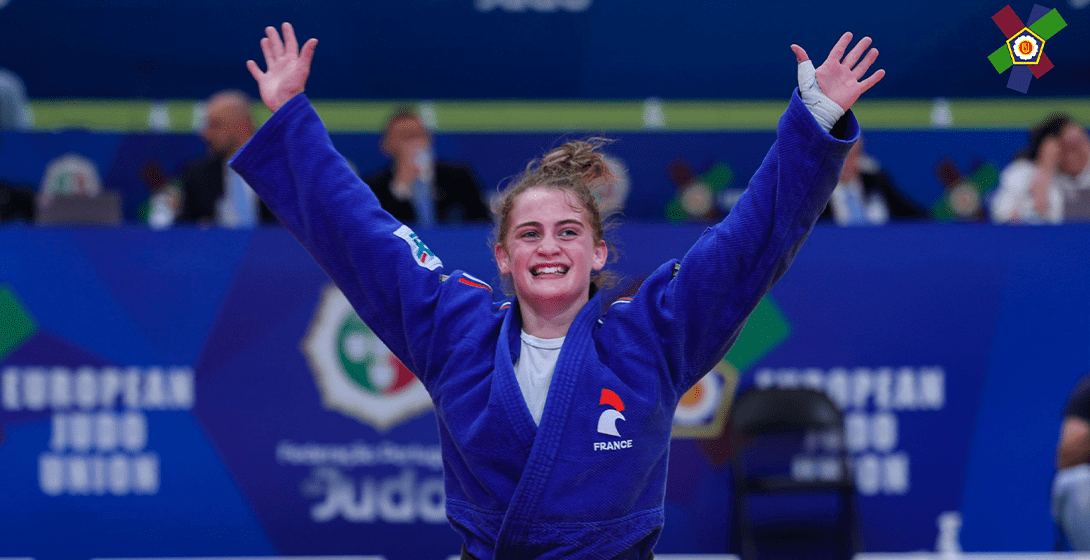Vous êtes une fervente militante du sport féminin, un combat qui trouve racine dans votre enfance : votre père, entraîneur d’aviron, vous refuse l’accès à son club pour le seul motif que vous êtes une fille. Comment l’a-t-il justifié ?
Je ne sais pas si c’est ce qui a nourri mon engagement mais j’ai toujours eu envie de faire du sport et ce, dès mon plus jeune âge, pour la simple et bonne raison que notre père nous en avait donné le goût.
Il se trouve que j’évoluais dans un environnement aviron – mon père avait pratiqué au niveau national avant de se retrouver dans l’encadrement. – alors j’ai eu envie, à mon tour, de pratiquer. Ça a été le premier refus auquel j’ai été confrontée. La raison invoquée c’est que, à l’époque, il n’y avait pas de filles en aviron à Aix-les-Bains où nous habitions, mon père m’a donc dit que ce n’était pas possible.
Après cela, j’ai pris le parti de faire du ski, j’ai même fait du hand mais j’avais moins d’appétence pour le sport collectif. Par la suite, par hasard, je me suis mise au vélo avec l’un de mes cousins. Je m’en sortais bien et c’est comme cela que tout s’est enchaîné, j’ai pratiqué le vélo parce que je ne pouvais pas faire d’aviron.
Comment avez-vous reçu son refus ?
Presque naturellement. Ça se serait passé aujourd’hui, je pense que je serais montée dans les tours mais, à l’époque, non. Je suis née en 1958, c’était différent, il y avait des sports pour les filles et des sports pour les garçons, du moins c’est ce que la société nous renvoyait.
Je n’étais pas contente de son refus mais je me suis simplement dit que j’allais faire autre chose. Quarante ans plus tard, être barrée au seul motif que l’on est une fille n’est plus acceptable. On considère désormais que le sport est accessible et aux filles et aux garçons.
Il y a eu des conquêtes importantes en ce qui concerne l’accès à la pratique, maintenant il faut avancer sur le sujet du traitement égalitaire dans le sport.
Le cyclisme est, pour vous, ce que vous qualifiez de pratique par défaut. Qu’est-ce qui fait que vous vous êtes engagée dans la voie du haut niveau à travers cette discipline ?
J’ai aimé le vélo parce que j’ai eu des résultats tout de suite et ça, c’est valable chez les garçons comme chez les filles : vous aimez aussi les choses parce qu’à un moment donné, vous réussissez, quel que soit le niveau.
En 1983, vous avez 25 ans et vous devenez membre de l’équipe de France de cyclisme. Qu’est-ce que ça signifiait pour vous ?
Quand je suis entrée en équipe de France, pour moi c’était d’abord la découverte. Je n’avais pas forcément de notions de ce qu’était une équipe nationale, de ce que l’on attendait de moi dans ce cadre, c’était très nouveau, d’autant plus nouveau, d’ailleurs que, que ce soit en cyclisme ou dans les autres disciplines, le sport de haut niveau féminin se construisait. Il y avait un peu d’incertitudes, des dysfonctionnements…
Le bon côté de la chose, c’est que, vu le contexte, vous ne calculiez pas. Moi, j’étais fière de représenter mon pays, il y avait cette notion d’appartenance à une nation, la fierté de pouvoir la servir par le biais du sport et c’est quelque chose qui m’a toujours animée. Pour moi, cela signifiait : donner le meilleur de moi-même.
Durant votre carrière de coureuse, vous allez disputer le Tour de France qui renaît alors de ses cendres. La première édition a lieu en 1984, vous êtes sur la ligne de départ. Ce qui peut paraître une opportunité énorme ne l’est, en réalité, pas forcément. La course a été mise sur pied très rapidement sans préparation suffisante, autant physique que mentale. Vous l’avez vécu comment ce Tour ?
Personne ne savait où nous allions, ce qui a créé beaucoup de cohésion dans l’équipe. Nous avions un entraîneur qui évoluait chez les garçons et qui avait été désigné pour venir nous encadrer. Pour lui aussi, c’était une découverte.
Il ne nous connaissait pas, il ne savait pas si nous allions être capables de courir trois semaines… C’était une aventure collégiale. Le gros point d’interrogation avec le Tour était de savoir jusqu’où nous pouvions aller, si nous allions pouvoir terminer la course et dans quel état, comment repousser nos limites…
En somme, il fallait voir si nous étions en capacité de et je pense que c’est là que l’on a découvert que les femmes étaient capables de.
Aviez-vous en tête l’idée que, si vous passiez à côté, les générations à venir en seraient probablement impactées ?
Ça ne se mesurait pas très concrètement mais il y avait de notre part cette envie de prouver. Nous étions fières d’avoir été choisies et nous voulions réussir.
Nous vivions des premières et nous étions des pionnières, mues par cette volonté d’y arriver afin de pouvoir dire : « Oui, vous pouvez faire confiance aux femmes, on est capables de ».
Vous avait-on donné les moyens pour réussir ?
D’un point de vue du traitement matériel, nous avons eu des conditions normales d’encadrement avec des mécaniciens, des kinés mis à disposition… À ce niveau-là, nous étions traitées de façon égalitaire.
En ce qui concerne le versant financier, c’était différent. Nous n’étions pas payées pour ça et nous avons pris des congés pour pouvoir participer au Tour de France. Moi, j’ai pris trois semaines de vacances.
Comment avez-vous été reçues par les médias, le public ?
Le traitement médiatique a été extraordinaire avec des reportages de quatre à cinq minutes par jour. En ce qui concerne le public, il n’y avait pas eu de publicité pour la course en amont. Tout s’est fait sur le moment, pendant l’épreuve.
Quand nous passions sur les routes, et notamment dans les cols, quand ça n’allait pas trop vite, nous entendions les gens dire : « Oh, mais vous avez vu, ce sont des femmes ! ». C’était incroyable. Il y avait un effet de surprise qui était magique.
Vous allez mettre un terme à votre carrière de cycliste en 1989 parce que vous ne pouvez pas vivre du sport mais vous avez néanmoins envie de continuer à évoluer dans ce milieu et vous allez entraîner. Là encore, être femme et entraîner relève de l’exception.
J’ai eu envie d’entraîner parce que, sûrement inconsciemment, j’ai constaté, et notamment lors du Tour de France, qu’il y avait peut-être une méconnaissance de ce qu’était la femme. Je croyais, et je le crois aujourd’hui encore d’ailleurs, que l’on n’entraîne pas les hommes comme on entraîne les femmes.
Ceci étant, les hommes peuvent très bien encadrer des femmes mais à condition d’avoir travaillé sur ce sujet, d’avoir compris comment elles fonctionnent. J’en avais fait l’expérience lorsque j’étais monitrice de ski. Vous ne dispensez pas la même chose aux hommes et aux femmes, la manière de le faire est différente et c’est là toute la richesse.
À vos débuts, votre souhait était d’encadrer des femmes ?
Non. Pour moi, la richesse de ce métier était qu’une femme puisse entraîner des hommes et inversement. Lorsque j’ai pris les rênes du vélo club d’Annemasse, j’ai reçu le président de l’époque qui se présentait alors comme coureur. Il pensait que j’étais la secrétaire. Je m’en rappellerai toute ma vie.
Nous en rigolons aujourd’hui mais, à l’époque, il fallait casser des codes.
Vous étiez seule à passer vos diplômes d’entraîneur ou est-ce qu’il y avait d’autres femmes avec vous ?
J’étais toute seule sur cette session et ça vous met la pression. Vous avez l’impression de venir chercher quelque chose de peu courant, quelque chose qui ne vous est pas destiné. Ça faisait partie du jeu.
J’ai toujours été une femme ambitieuse – ce qui est un gros mot dans la bouche d’une femme -, je voulais réussir et, pour cela, je ne lâchais rien. On disait d’ailleurs de moi que j’avais un sale caractère. Moi je dis simplement que j’avais – et que j’ai – du caractère.
Il n’y avait pourtant pas forcément de débouchés pour une femme entraîneure. Qu’est-ce qui vous a poussée à vous accrocher ?
Je faisais de ces difficultés des challenges. Je me disais que j’allais leur montrer à tous que c’était possible. Il fallait faire évoluer la société et on voyait qu’en parallèle les choses avançaient.
Il y avait des réseaux féminins d’entreprises qui se créaient, une politique ministérielle qui bougeait. Marie-George Buffet a joué un rôle important dans ce cadre-là et je me suis beaucoup appuyée sur elle. Si j’ai mené ce combat, c’est qu’il y avait une volonté institutionnelle, une volonté politique de faire bouger les choses, ce qui faisait que nous n’étions pas seules.
Encore aujourd’hui, on ne peut pas bouger toutes seules. Il faut qu’il y ait des lois, par exemple la loi sur la parité 2024, des engagements politiques… Ce n’est que collectivement que l’on gagnera.
Vous allez vivre une expérience au Vélo Club d’Annemasse, un club masculin. Comment avez-vous réussi à intégrer cette structure ?
C’est d’abord un homme qui m’a fait confiance. Un président de département et de club qui a eu le courage d’oser prendre une femme. Il y avait eu, à l’époque, un article dans Le Dauphiné dans lequel il avait dit : « Je fais le pari de prendre une femme ». Sans s’en rendre compte, il était avant-gardiste sur le sujet.
Encore une fois, pour que ça fonctionne, il faut là encore beaucoup de soutien et c’était sa posture. Il arrivait souvent que je débarque sur les courses et que l’on me demande si j’étais la kiné ou la femme du président !
Quelle a été l’attitude des coureurs ?
C’est drôle car, en en discutant, il y a plein d’images qui me reviennent. Il y avait à la fois un peu de réserve, ils attendaient de voir comment j’allais faire, et puis aussi de la fierté.
Fierté parce qu’être coaché par une femme était nouveau, fierté parce que les médias s’intéressaient à notre équipe à cause de ça. Moi, je n’ai jamais eu de problème avec cette équipe.

Marie-Françoise Potereau avec la 4e du Tour de France Femmes 2022, Juliette Labous
Quand on se construit dans la différence, comment parvient-on à ne jamais renoncer ?
J’y ai toujours cru. Il y a parfois eu des moments de doute mais je pense que j’avais une force de caractère en moi. Je savais où je voulais aller : plus loin et, jusqu’à mon dernier souffle, je veux faire des choses qui font bouger les lignes.
Autre première pour vous, en 1992 vous passez le concours de la fonction publique qui n’était, jusqu’alors, pas ouvert aux femmes…
Ce concours permettait d’accéder aux métiers de cadres techniques du ministère des Sports et, par la suite, d’être positionné soit auprès d’une fédération comme entraîneur, soit sur un poste dit « déconcentré » à savoir, à l’époque, les directions régionales jeunesse et sport.
Après avoir été entraîneure de club, je voulais progresser. J’ai passé le concours et je l’ai réussi mais la Fédération de cyclisme ne m’a pas nommée comme entraîneure. Le président de l’époque me disait que, en tant que femme, je ne pouvais pas accéder à ces postes-là.
Comment avez-vous réussi à vous imposer jusqu’à devenir vice-présidente de la Fédération Française de Cyclisme ?
J’ai continué à leur casser les pieds en leur demandant sans cesse : « Pourquoi ne prendriez-vous pas une femme ? ». Je faisais mon travail très correctement et, occasionnellement, on me donnait l’équipe de France junior à encadrer mais pas de poste officiel. Tout cela s’est fait au fur et à mesure.
Aujourd’hui, il m’arrive de recroiser ces hommes qui ont eu des doutes et il y a beaucoup de bienveillance à mon égard, de sourire aussi. Ils se disent que, peut-être, quelque part, ils ont été bêtes et ils sont reconnaissants du parcours qui est le mien. De cette reconnaissance, ils font du respect.

Marie-Françoise Potereau avec, au centre, l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu et la réalisatrice Marie Lopez-Vivanco, à droite.
À partir de 2000, votre engagement devient plus politique. Vous allez notamment prendre la direction de Femix’Sports, une association dont le but est de promouvoir et de valoriser la place des femmes dans le sport. Qu’est-ce qui explique, selon vous, qu’un siècle environ après l’avènement du sport féminin en France, nous soyons si en retard sur la question ?
Le sport a été construit par les hommes pour des hommes. Quand les femmes ont commencé à faire du sport, on a mis en place des règles spécifiques pour tout : les distances, les tenues… Pourquoi n’y a-t-il pas les mêmes règles au départ par les femmes pour les femmes ?
On n’a pas à en vouloir à ces pionnières, mais on a fait une erreur car nous sommes imprégnés de notre histoire de départ et c’est le poids de cette histoire qui fait que l’on en est là où nous en sommes aujourd’hui.
Dans son ouvrage « Des femmes et du sport », Anne Saouter dit que les femmes n’étaient pas prévues. Et c’est vrai, elles n’étaient pas prévues dans ce monde-là !

Marie-Françoise Potereau et la cycliste Estelle Andrieu
Comment a évolué, selon vous, le panorama du sport féminin français en vingt ans ?
Il y a une vraie dynamique, une vraie évolution mais nous sommes encore dans le trop peu ou le pas assez. Je me rends cependant compte du poids des stéréotypes dans ce constat.
Au moment de la campagne pour la loi sur la parité, j’échangeais avec Amélie Oudéa (ministre des Sports, Ndlr). Moi, je prônais la mixité, je pensais que la parité, c’était trop tôt et elle m’a dit : « Non, sinon on mettra encore des siècles ». Elle avait raison. La loi sur la parité est passée et depuis, tout le monde s’affole et essaie de trouver des solutions.
Il faut que l’on soit dans cette logique de tendre vers une parité partout et peu importe si dans les fédérations, tous les sièges ne sont pas pour nous. Nous allons y arriver grâce à cette loi et parce que nous mettons des actions en place.
Il ne faut cependant pas oublier d’associer les hommes dans notre stratégie. Pour pouvoir avancer ensemble.
D'autres épisodes de "Cyclisme, dans la roue des sportives"