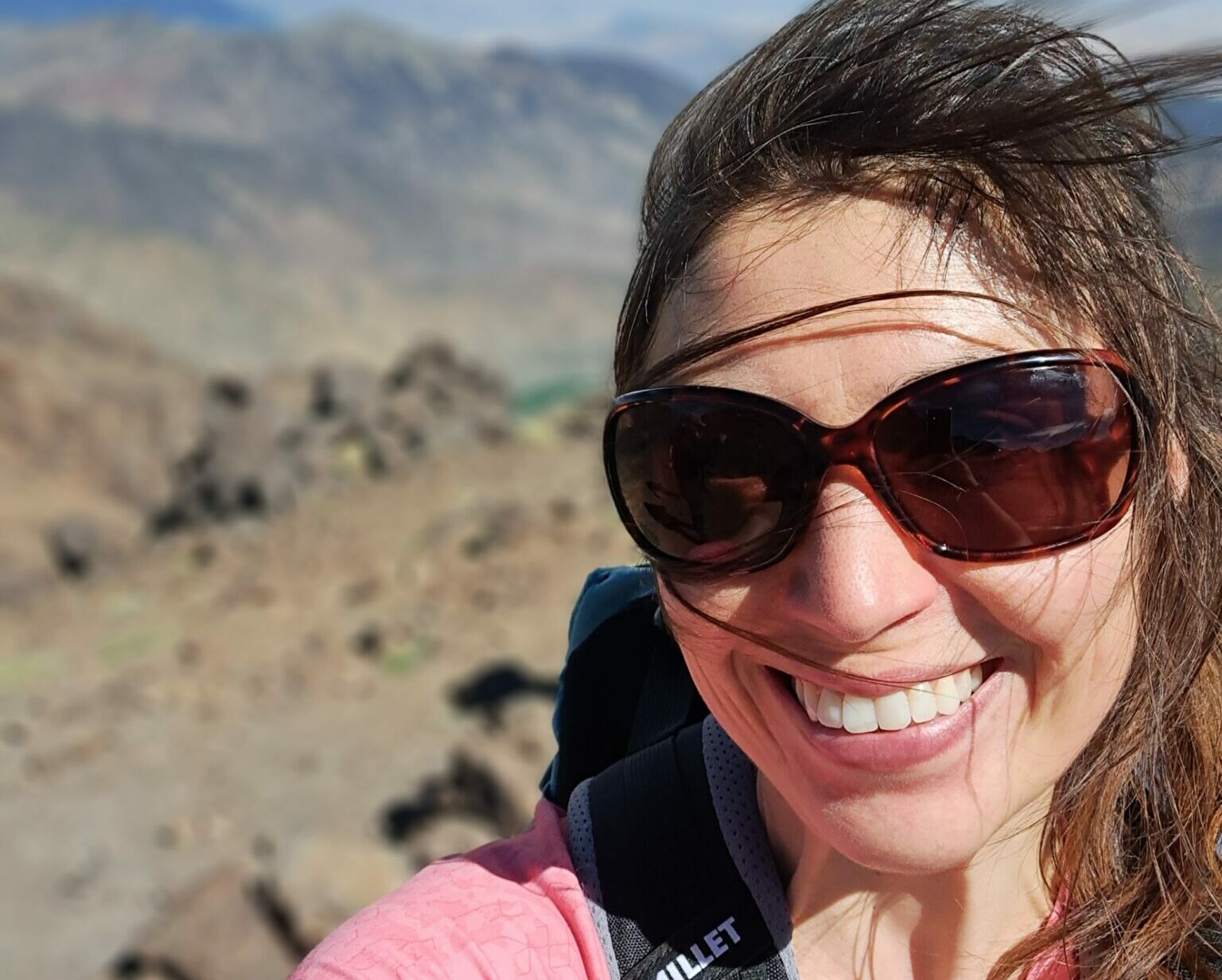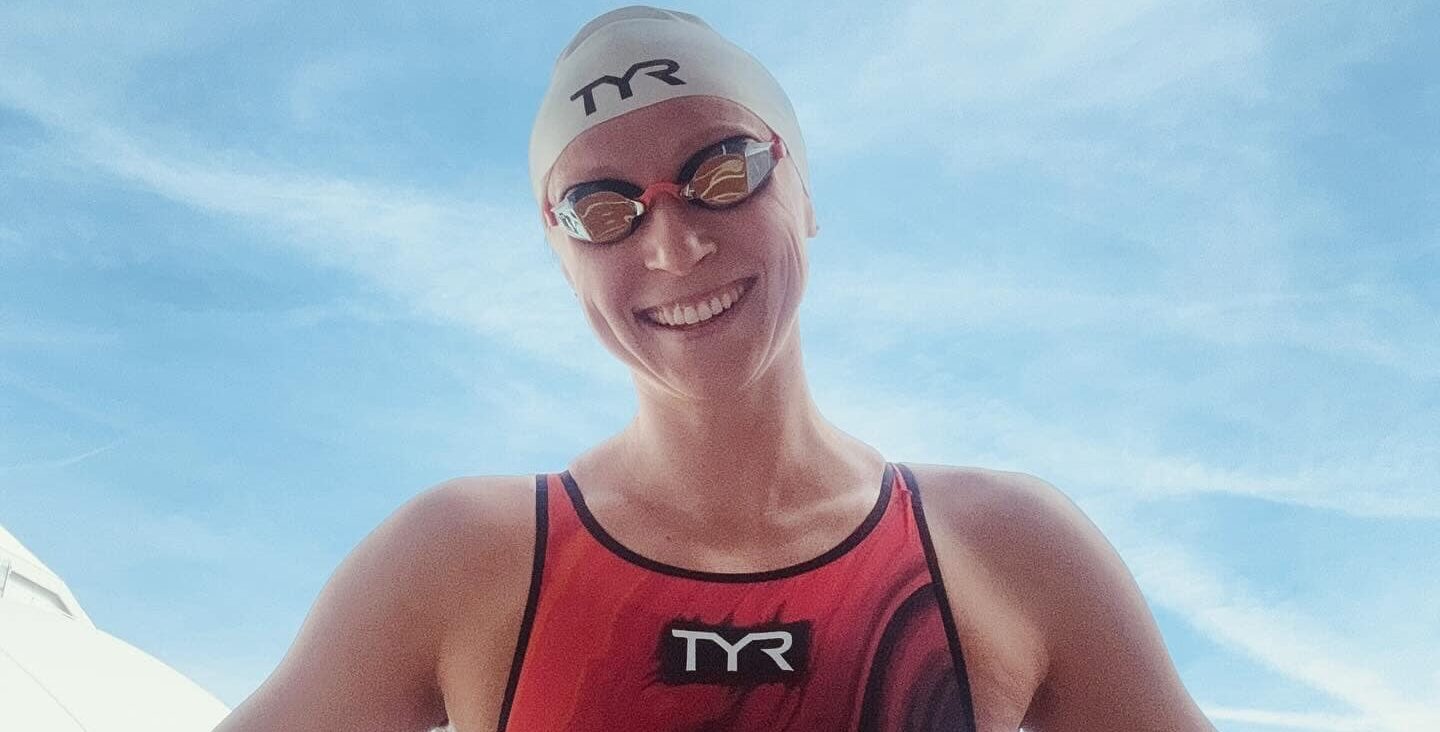« J’ai toujours pratiqué des activités sportives. Ça tenait à cœur à mes parents. Mais je n’étais pas autant investie qu’aujourd’hui ! J’ai testé le tennis, la natation, l’équitation… Et c’est l’équitation qui m’a vraiment convaincue. J’ai commencé en primaire quand nous habitions encore à Paris puis en Auvergne quand on a déménagé. Je suis allée jusqu’à mon galop 2. Mais je crois que c’était le lien avec les animaux qui me plaisait surtout. Le fait de ne faire qu’un avec le cheval.
Puis, c’est devenu un peu compliqué pour moi de monter à cheval. C’était les débuts de ma maladie, mais je ne le savais pas. Je voyais juste que j’avais un problème d’équilibre. Vers l’âge de 13 ans, j’ai eu différents symptômes : je me levais avec des vertiges, je devais me tenir au mur du couloir pour ne pas tomber. Je pensais simplement que j’étais fatiguée. Après, c’est allé plus loin. J’ai commencé à beaucoup chuter, à l’école, en rentrant chez moi… Je faisais tout pour cacher mes pantalons troués. Mes parents m’ont alors imposé d’aller voir une neuropédiatre.

Au début, je n’ai pas trop compris ce qui m’arrivait. Quand la médecin m’a expliqué ce que j’avais, j’ai cru qu’il manquait simplement un produit dans mes muscles et que cela me rendait plus faible que les autres. Je pensais qu’il me suffisait de prendre un traitement comme une cure de vitamines et que ça irait mieux. Mais elle s’était trompée de diagnostic. J’ai su officiellement un an après ce qui m’arrivait. Un neurologue m’a fait un examen très douloureux afin d’accélérer la recherche. C’est alors qu’il m’a dit que ça pouvait être super grave, que ça pouvait toucher le cœur. Je pense qu’il n’avait pas l’habitude de parler à des enfants… Quand tu es jeune et qu’on te dit que ce que tu as affecte ton cœur, tu te dis que tu as une espérance de vie réduite. C’est assez dur à vivre. Je me souviens d’avoir dit à ma petite sœur que j’avais un truc grave même si je ne savais pas encore précisément ce que c’était. J’avais même demandé à ma mère si j’allais mourir.

À cette période, je n’avais pas encore tous les symptômes de ma maladie. On m’a fait un scanner du cerveau et je n’avais rien. Et pourtant, le diagnostic est tombé deux mois après : j’avais l’ataxie de Friedreich, une maladie génétique neurodégénérative rare. C’était il y a dix ans, en septembre 2015. Je n’ai aucun souvenir de ce rendez-vous, hormis le regard plein de tristesse de ma maman.
Très vite, j’ai compris que je devais continuer le sport, qu’il ne fallait surtout pas arrêter. Ça peut ralentir l’évolution de la maladie qui, pour l’instant, n’a pas de traitement adapté même si c’est en cours. Ce que m’a dit mon père quand j’ai été diagnostiquée est resté mon principe de vie depuis : « Tu dois avoir l’hygiène de vie d’une sportive de haut niveau. » Il a toujours fait beaucoup de musculation car il participe à des triathlons et des marathons, on avait même une petite salle dédiée à la maison. C’est donc lui qui m’a coachée. Ma neuropédiatre m’a dit que je devais rendre ma vie la plus normale possible : études, sport, sorties avec les amies, etc.

Moi, petite, j’étais du genre à me ficher de pas mal de choses. Donc, honnêtement, j’ai été triste une seule journée de ce qui m’arrivait. C’était surtout ma mère qui le vivait très mal. Elle regardait tout le temps comment je marchais pour voir dans quelle mesure la maladie évoluait. C’était à moi de rassurer ma mère tout le temps. Je cachais mes genoux et je disais que tout allait bien. J’ai dû prendre en maturité très vite pour adopter cette posture rassurante envers mes parents.
En seconde, j’ai développé mon diabète de type 1. C’était un deuxième diagnostic, à peu près un an après le premier. Là, j’ai été un peu triste sur le coup, mais ça allait même si j’avais la phobie des piqûres. D’ailleurs, maintenant, je suis obligée de me faire des injections plusieurs fois par jour. J’ai appris à vivre avec tout ça. Un an après, j’ai commencé à ressentir des difficultés à marcher, je devais prendre des bâtons. Les professeurs disaient que j’avais des cannes. Ça m’énervait. Moi, je disais que c’était mes sceptres.

Durant cette période, au lycée, j’ai eu besoin de raconter mon histoire. Je me suis mise à écrire dans mon journal puis, ensuite, sur Instagram, comme aujourd’hui. Je commençais à voir réellement les difficultés que la maladie pouvait engendrer. J’avais besoin d’extérioriser tout ça : écrire des poèmes me rassurait. À l’époque, j’avais beaucoup d’espoir car un généticien spécialiste de la maladie avait parlé d’une thérapie génique qui pouvait me guérir.
Mais en fait, un an plus tard, il n’y avait toujours rien. Je ne parvenais presque plus à marcher avec mes bâtons, j’en étais désespérée, je me souviens avoir pleuré dans son bureau. Je lui ai dit que je ne pouvais pas tenir plus longtemps. Et puis, j’ai rencontré l’équipe de rugby fauteuil de l’ASM (Association Sportive Montferrandaise) à Clermont-Ferrand, là où je vis. Je crois bien avoir provoqué mon destin en allant essayer ce sport. Je savais sûrement au fond de moi que je finirai en fauteuil.

Après le lycée, je suis partie à la fac en sciences du langage, je voulais être orthophoniste. Je savais qu’il allait falloir que je passe au fauteuil roulant mais j’étais terrifiée à cette idée. Je ne voulais pas, j’étais révoltée. Je me disais : « Mais ils pensent pouvoir prédire l’avenir ? » Je suis allée rencontrer les pratiquants de rugby-fauteuil et, là, je n’ai vu que des sourires alors qu’ils étaient tous en fauteuil. J’ai vraiment pris du bon temps à jouer avec eux, pourtant je n’étais pas si sportive que ça. Je n’avais jamais fait de sport collectif. Et j’ai découvert une super bonne ambiance.
Ce que j’aime dans le rugby fauteuil, c’est le fait que ce soit un sport de contact, qu’on se rentre dedans comme à la fête foraine avec les auto-tamponneuses. On se fait pas mal, ce sont les fauteuils qui prennent. Ça n’a rien à voir avec le rugby classique : on joue avec un ballon de volley, on ne fait pas de passes en arrière mais plutôt en cloche pour passer bien au-dessus des joueurs. Moi, je joue en défense et j’ai une grille devant mon fauteuil qui me permet de venir bloquer les joueurs du camp adverse. Comme ça, ils ne peuvent plus avancer, et le porteur de balles peut passer facilement la ligne du camp adverse avec le ballon sur les genoux.

Le rugby fauteuil, c’est vraiment un sport de stratégie. Comment tu vas placer ton fauteuil pour aller faire un bloc ? Comment tu vas anticiper certaines choses ? Il faut constamment réfléchir à ton placement sur le terrain. Comme je ne suis pas hyper rapide, il faut pallier à ça en anticipant beaucoup. Surtout quand on joue avec des mecs. La différence de niveau est quand même là. On est un petit peu moins fortes en tant que femmes. En tout cas, c’est ce que j’expérimente quand j’ai l’occasion de jouer avec des athlètes féminines : les chocs sont beaucoup moins violents. Dans ce sport, il faut être combative. Il ne faut pas avoir peur de se faire rentrer dedans. Moi, je suis assez fine donc je décolle quand les mecs me tapent dedans.
Au début, je n’étais vraiment pas douée ! Je n’avais pas l’habitude du fauteuil roulant. Il fallait que j’apprenne à le manier. Je ne comprenais pas comment tourner. En revanche, je suis presque avantagée par rapport aux autres parce que je joue majoritairement avec des personnes tétraplégiques, qui n’ont pas la mobilité des mains et des doigts. Alors que moi, même si j’ai beaucoup de problèmes au niveau des réflexes et de la coordination, j’ai la mobilité de l’ensemble de mes articulations. Je peux faire des passes un peu plus précises, par exemple. Très vite, j’ai su que je continuerai. J’ai tout de suite aimé, ils sont tous super gentils.

J’ai donc été ok pour passer sur le fauteuil. Je n’avais pas encore le permis et mes parents habitaient à trente minutes de Clermont. C’est donc un copain qui venait me chercher pour m’emmener à l’entraînement. Il m’a tout appris avec le fauteuil et j’ai compris qu’il était possible de faire tellement de choses ! Il m’a montré comment plier son fauteuil quand on est en voiture, comment conduire. L’idée de savoir que tout était possible en fauteuil, ça m’a vraiment libérée et j’ai vu ça autrement.
Pour commencer, j’ai demandé à un copain de me prêter son ancien fauteuil : je suis allée à Disney, faire les magasins, dans des bars avec mes amis. Et je me suis rendue compte qu’il ne faut pas se sentir stigmatisé par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que, personnellement, je retrouvais une mobilité que la maladie m’avait fait perdre. Je retrouvais donc une liberté. C’est pour ça que je dis que le fauteuil roulant m’a sauvée. Ce n’est pas la même chose pour les personnes accidentées qui se sont retrouvées, du jour au lendemain, paralysées.
Pour en revenir au rugby, la cohabitation avec les mecs (niveau National 3) se passe bien, mais c’est vrai que je commence à remarquer des petites choses que je ne voyais pas forcément avant. En plus, je suis la seule fille de l’équipe en ce moment, avant on était deux. Parfois, j’entends des commentaires qui me mettent à l’écart, comme « Ne faites pas la passe à Pauline ». Je subis un peu ce truc des mecs qui se sentent les plus forts…
Ce qui a changé les choses pour moi, c’est qu’on a récemment créé une équipe de France féminine de rugby fauteuil – même si je continue toujours avec mon équipe mixte – mais on n’est pas encore reconnues par la fédération française de rugby fauteuil. Du coup, j’ai retrouvé mon ancienne coéquipière. On avait le même sentiment sur l’attitude des garçons. En échangeant entre filles, en général, on remarque des comportements communs chez les hommes. Par exemple, quand une fille est sur le terrain, les mecs disent : « Prends la fille » au lieu de dire notre nom ou notre numéro de maillot. Même parfois, ils se marrent quand il y en a un qui bloque une fille, en mode : « Ils se font une date ! ».
Cet été, on a fait un stage en Angleterre avec l’équipe féminine, c’était extra. Ça m’a fait un bien fou. En fait, on se bat un peu pour être reconnues et avoir des aides, pouvoir faire de la compétition, etc. Il faut absolument des équipes féminines et non mixtes parce que le constat, c’est que, pour les filles, c’est compliqué de jouer, d’aller sur le terrain et d’être prises au sérieux. Après, il y en a qui ont leur place, qui arrivent à se montrer intéressantes sur le terrain. Mais, pour certaines, c’est compliqué.

Le rugby fauteuil, ça m’entretient : la mobilité des bras, l’équilibre du tronc, le fait de rattraper les ballons, c’est tellement complet comme sport ! Ça me sauve en termes de physique, pour ralentir l’évolution de la pathologie, mais aussi en termes de santé mentale. J’ai commencé la musculation en parallèle du rugby fauteuil : de la préparation physique avec des coachs à l’ASM Omnisport et ensuite de la muscu en salle. Ce qui me faisait peur, c’était le regard des autres et, en fait, je me suis carrément fait des potes. Ils m’ont dit que je ne devrais pas avoir peur ni me cacher, beaucoup sont admiratifs.
Je me débrouille seule pour aller aux entraînements, j’ai ma voiture maintenant. Parfois, je me dis que sans ma maladie, je n’aurais peut-être pas développé la force que j’ai. Je ne me considère pas comme une personne en situation de handicap. D’ailleurs, j’ai mis longtemps à l’admettre. Maintenant, je n’ai plus aucun mal avec ça. Au quotidien, je ne me sens pas limitée. Quand j’ai été diagnostiquée, si on m’avait dit que plus tard, je pourrais faire des études, que je voyagerais pour le travail, que j’irais jusqu’en Angleterre pour jouer avec mon équipe féminine de rugby fauteuil, je ne l’aurais pas cru…

Le rugby fauteuil a clairement fait partie de ma reconstruction, mais ce dont je suis la plus fière, sportivement parlant, c’est la création de cette équipe féminine. Le moment fort pour moi, ça a été de jouer dans le stade où ont eu lieu les Jeux Paralympiques. On portait les couleurs de la France, on chantait la Marseillaise et il y avait même des journalistes rien que pour nous. C’était dingue d’avoir vécu ça. On est arrivées quatrièmes, ça fait un peu mal d’avoir raté le podium à une place près, mais bon, ça nous fait un objectif pour la prochaine Women’s Cup !
Et j’espère qu’on va intéresser de plus en plus de monde car l’engouement suscité autour des Jeux est un peu retombé : aujourd’hui, je trouve qu’on est super loin de tout ce qui a pu être dit pour faire avancer les dossiers du handisport. On voit bien qu’on n’a plus autant de budget qu’avant. Alors que dans certains pays, les infrastructures sont bien adaptées, comme j’ai pu le voir en Angleterre. Exemple : dans toutes les toilettes, il y a une petite corde rouge qu’on peut tirer si on tombe. Moi, j’ai la chance de vivre avec mon copain, mais quand il n’est pas là, si l’ascenseur de mon immeuble ne marche plus, par exemple, je reste coincée. C’est le cas ces derniers temps et c’est un enfer à vivre.

J’ai beau lutter, la maladie reste plus forte. Il m’arrive d’avoir des moments où j’ai moins envie de faire du sport, où je suis moins motivée, où j’ai envie de laisser tomber. Ça m’est déjà arrivé parce que c’est trop dur, on ne va pas se mentir. Mais en fait, je me dis que… je n’ai pas le choix. La maladie ne me laisse pas le choix. Et ça, c’est un truc que j’essaie de faire comprendre à mon copain quand il ne veut pas aller s’entraîner le week-end et qu’il veut rester tranquille à la maison. Je lui dis que, moi, je n’ai pas de répit. Même si maintenant, je me suis calmée avec ça. Mais avant, je me disais qu’une journée sans sport, c’était une journée de plus pour laisser la maladie s’intensifier, prendre le dessus. J’étais très disciplinée et stricte avec moi-même.
Aujourd’hui, je suis un peu plus relax car j’ai d’autres priorités, avec ma vie personnelle et mes études – je travaille en alternance au sein de l’association Tourisme & Handicaps sur le développement d’une application et d’un site, My Easy Access, pour aider à la mobilité des personnes en situation de handicap. J’ai aussi créé un magazine qui met en avant les femmes dans le handisport, inspirée par la Women’s cup. Comme mon compte Instagram, il porte le nom de mon mode de vie « Extreme Living ».

L’« Extreme Living » (mode de vie extrême, Ndlr), pour moi, c’est une manière d’imager ma vie dans laquelle tout est difficile et intense même dans les choses les plus simples comme s’habiller, faire à manger, prendre la voiture… Dans mon magazine, j’ai mis une citation à ce propos : « Vivre de manière extrême ne signifie pas pratiquer des sports dangereux, mais ça signifie repousser les limites imposées par la génétique, vivre passionnément, pleinement et croquer la vie à pleine dents ». Je m’engage ainsi à continuer cet « extrême living » pour avoir la vie que je désire, rassurer ma mère, rendre mon père fier. C’est à lui que j’ai promis de vivre en sportive de haut niveau. »
- Pour garder la foi et la force à toute épreuve, suivez Pauline, la joueuse de rugby fauteuil la plus motivante qui soit, sur sa page Instagram @extreme_living_fa