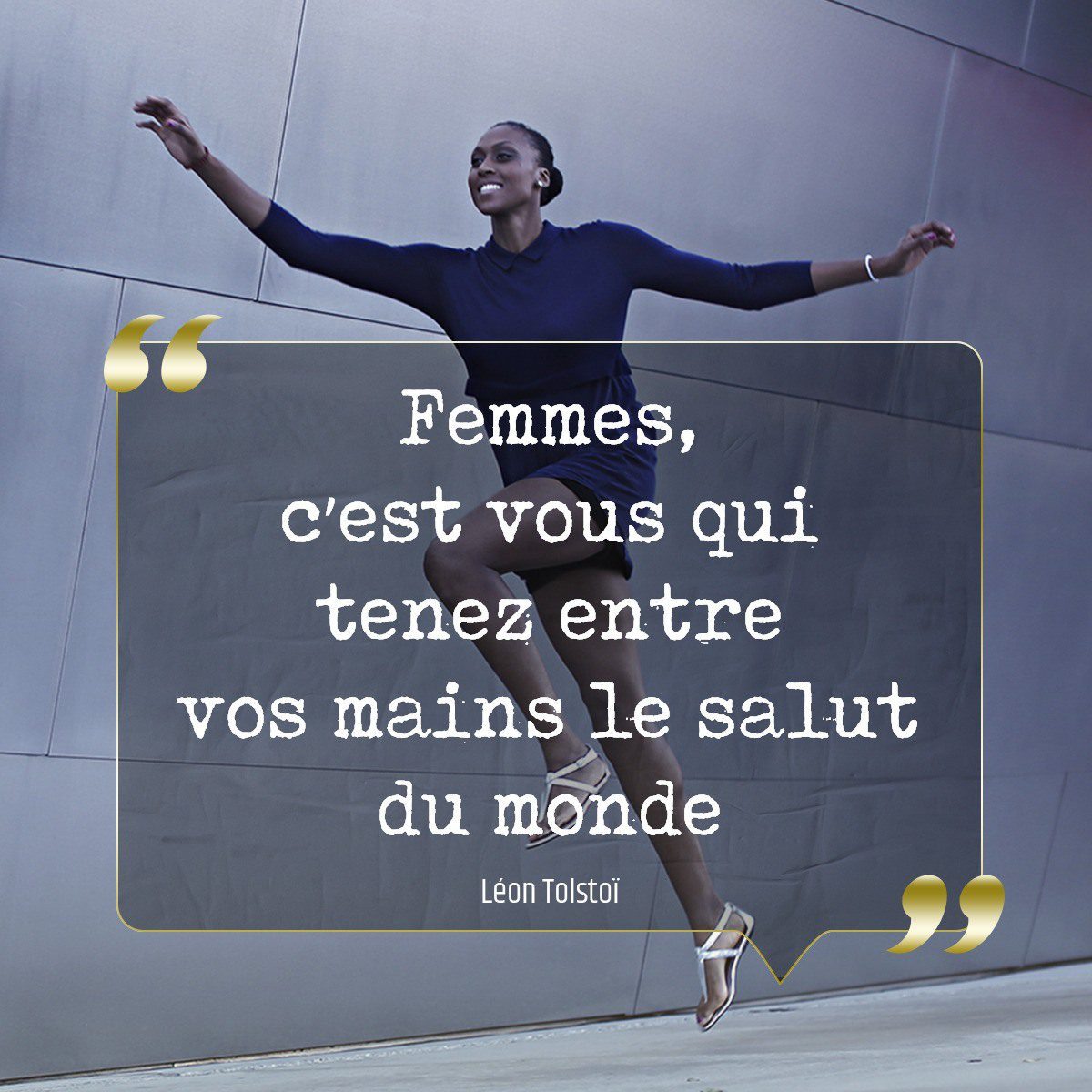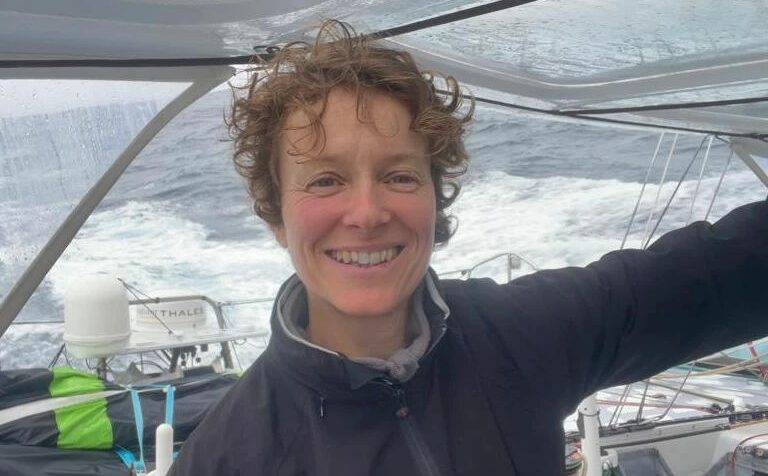Ton amour du basket te vient de ton père, Ulysse Gruda. Il était joueur professionnel au début des années 80, sept fois capé en équipe de France et a joué, notamment, à Golfe-Juan avant de devenir coach. Comment t’a-t-il transmis sa passion ?
Enfant, j’étais une fille à papa. Petite, mon père entraînait une équipe de femmes. Je le suivais dans quasiment toutes ses aventures et c’est comme cela que je me suis retrouvée sur un terrain de basket à le regarder coacher.
De fil en aiguille, j’ai commencé à manipuler le ballon, pour faire passer le temps, et puis je me suis éprise de ce jeu.
Tu n’as jamais pratiqué d’autres sports que le basket ?
Si, je me suis aussi intéressée à d’autres sports. Ma première licence, je l’ai prise quand j’avais 6 ans, je crois. Avant, j’avais commencé à jouer au ballon, pas au basket mais au ballon.
Par la suite, en grandissant, j’ai essayé l’athlétisme, la danse, le tir à l’arc, la gymnastique rythmique… Je faisais plusieurs sports à la fois et puis j’ai tranché pour le basket.
J’ai arrêté le tir à l’arc parce que je n’étais pas patiente. Les deux sports qui sont restés étaient le basket et l’athlétisme.
J’aimais assez courir, mais je pense que j’ai opté pour le basket parce qu’il y avait un effet de groupe et que c’était plus fun.
Il y avait aussi le fait que j’étais beaucoup plus douée pour le basket que pour l’athlétisme…
Adolescente, tu quittes la Martinique et le pôle Espoir de Trinité pour rejoindre la Métropole et suivre un cursus fédéral. Est-ce que le basket était déjà, pour toi, un projet de vie ou est-ce que tu suivais le mouvement parce tu étais douée, sans savoir où ça te mènerait ?
J’ai fait un choix, celui, à 13 ans, de devenir professionnelle. On ne traverse pas 8000 kilomètres en se disant simplement : « Tiens, je me lance, je vais voir ce que ça donne ! ». On ne crée pas ce déchirement familial, social, culturel juste pour tenter, en tout cas, ce n’est pas ma vision des choses.
Ce choix de tout quitter pour rejoindre la Métropole ne peut pas se faire sur un coup de tête, il faut savoir ce que l’on veut, être suffisamment motivée et déterminée, même si, à 13-14 ans, c’est compliqué.
Le problème, aujourd’hui, c’est que les gens ne se fixent que des objectifs atteignables. Est-ce que je savais, à ce moment-là, que j’allais réussir et faire la carrière qui est la mienne ? Absolument pas !
En revanche, je savais que j’avais une détermination folle et que je voulais mettre toute mon énergie dans le basket.
Comment tu as vécu ce déracinement ?
C’était très compliqué. Il y a eu un choc culturel énorme et, la première année, j’ai eu un gros coup de blues.
Je vais rebondir, une fois encore, sur mon vécu mais je pense qu’il faut absolument dire aux jeunes, et surtout à leurs parents, qu’il faut être derrière leurs enfants. Si je n’avais pas été encadrée comme je l’ai été par ma famille, je n’aurais certainement pas fait la carrière que j’ai faite.
J’avais beau être déterminée, c’est mon père qui m’a dit : « Tu n’as plus rien à apprendre à la Martinique, tu pars à Toulouse ». Il y a eu aussi ma grand-mère, avec laquelle j’ai grandi, et qui, lors de mon coup de blues, m’a lancé : « Tu termines ce que tu as commencé ».
Si je n’avais pas eu ça, s’ils n’avaient pas été derrière moi, je serais probablement rentrée à la Martinique et, aujourd’hui, je ferais tout autre chose de ma vie.

Tout va s’enchaîner très vite pour toi. En 2005, tu as 18 ans et tu es recrutée par Valenciennes en qualité de quatrième intérieure. Très vite, tu fais la différence et tu t’imposes comme un élément majeur de l’équipe. En 2007, tu décroches le titre de championne de France, la Coupe de France et une place dans le Final Four de l’Euroligue. Ces débuts dans le basket pro, ça correspondait à ce que tu imaginais ?
J’étais heureuse et épanouie mais, en ce qui concerne les résultats, je n’avais pas d’attente particulière.
J’ai toujours fonctionné comme ça : je suis focus à 100 % sur les moyens et ce, dans tous les domaines de la vie. Si on y met les moyens, les résultats suivent ou, du moins, il n’y a pas de déception car, quoi qu’il en soit, on a tout donné.
Tu vas rester deux ans à l’USVO avant de prendre la direction de la Russie. Tu as 20 ans et tu t’engages avec Ekaterinbourg, dans le fin fond de l’Oural. Qu’est-ce qui a motivé ce départ ?
Je sais que c’est surprenant. Aujourd’hui encore, aucune joueuse française n’a quitté son pays à 20 ans. Ça choque, mais il y a tout un contexte qui explique que je sois partie.
La première raison c’est que, comme j’explose tout, je suis très vite repérée. J’ai trois offres : deux russes, une coréenne.
La deuxième raison est que, à l’époque, j’ai confirmation, de l’intérieur, que le club de Valenciennes ne va plus exister très longtemps, peut-être encore un an et après, ce sera fini.
Pour finir, le coach, Laurent Buffard, avait lui aussi reçu une offre d’un club russe. Je suis partie avec un cocon : le coach, l’assistant et la meneuse, tous les quatre à Ekaterinbourg. J’étais dépaysée, certes, mais sans forcément l’être d’un point de vue sportif.
Comment vit-on un début de carrière aussi fulgurant quand est très jeune ? Comment réussir à ne pas se laisser griser ?
C’est vrai que ça va vite pour moi, mais je pense que je ne comprends pas tout à fait tout ce qui se passe.
Et puis, quand j’arrive à Ekaterinbourg, j’évolue avec les meilleures, des femmes qui ont fait encore plus que moi. C’est ça qui alimente mon envie de continuer à travailler dur et à repousser mes limites.
En Russie, tu bénéficies de conditions extraordinaires. Tu as un interprète, un chauffeur, les déplacements se font en jet privé, tu gagnes très bien ta vie… Malgré tout, au début, c’est assez compliqué. Tu as un entraînement par jour et après il te faut tuer le temps. Comment fais-tu pour garder ta passion pour le basket intacte ?
J’ai pris de gros risques en partant là-bas : je ne savais pas si j’allais m’y plaire, si j’allais pouvoir jouer à mon niveau. Au début, j’étais intimidée.
J’étais, en quelque sorte, le petit Poucet parmi plein de grandes dames du basket, des filles dont je placardais les portraits sur les murs de ma chambre !
En prenant la direction de la Russie, je me challenge. C’est l’insouciance qui m’a amenée à partir là-bas, c’est l’insouciance qui m’a maintenue dans cette sphère sans que je ne me pose de questions.
J’étais reconnaissante d’évoluer dans l’un des meilleurs clubs européens et, sur le moment, j’acceptais la situation pour ce qu’elle était.
Cette parenthèse russe va durer neuf ans avec, à la clef, huit titres de championne de Russie, sept coupes nationales et deux victoires en Euroligue. Comment et en quoi la Russie a contribué à faire de toi la joueuse que tu es ?
En France, j’étais vue comme une extraterrestre parce que j’avais une approche du jeu, du travail et de l’effort assez singulière.
En arrivant en Russie, j’étais entourée de grandes joueuses, notamment d’Américaines, et je me suis rendu compte que je n’étais pas si éloignée de ce qu’elles faisaient. Elles m’ont permis de valider mon éthique de travail.
Il y aussi le fait qu’à Ekaterinbourg, j’étais tout le temps challengée. C’est facile de rester dans sa zone de confort et il aurait été plus simple, pour moi, de rester en France et de continuer à survoler les débats.
Là, je rebattais les cartes, il fallait que je fasse ma place, que je prouve et, pour prouver, il fallait que je bosse car aucune de mes coéquipières ne s’était dit : « Je vais laisser la petite jeune faire son trou, prendre des minutes de jeu ».
Ce n’était pas évident, j’ai opté pour un schéma un peu plus difficile mais qui m’a permis de rester focus et en adrénaline pendant longtemps.
En 2016, changement de cap, tu prends la direction de Fenerbahçe en Turquie. Qu’est-ce qui t’a donné l’envie de partir et de recommencer, une fois encore, de zéro dans un autre club ?
Je me suis blessée et, pour la première fois, j’étais écartée des terrains. J’avais un temps de réflexion et je me suis dit que c’était peut-être un signe, que j’allais partir pour essayer autre chose. Encore une fois, c’était un challenge et j’aime ça.
Quand on reste neuf ans dans un club, ça devient très confortable : on sait que l’on est appréciée par les dirigeants, on voit les filles arriver et puis partir et nous, on est encore là, c’est assez sécurisant.
À ce moment-là, il était nécessaire que je puisse me redonner des frissons, que je découvre d’autres pays.
Entre la Russie et la Turquie, il y a eu les États-Unis et la WNBA. Tu vas évoluer dans deux formations différentes, les Sun (Connecticut) entre 2008 et 2010 et les Sparks de Los Angeles entre de 2014 à 2017 avec une pause en 2015. Pendant six saisons, tu vas partager ta vie entre l’Europe de septembre à mai et les US de mai à août, sans compter tes sélections en équipe de France…
À ce moment-là, j’enchaîne pas mal ! Mais je vis un rêve. Pour moi, la WNBA a toujours été un rêve, avant même de rêver du championnat français, je rêvais de ça.
Je me suis faite drafter en 2007 et il fallait absolument que je puisse tester l’Amérique. C’était indispensable. Et comme la WNBA n’est qu’une ligue estivale, je n’avais pas d’autres choix que de jongler entre l’équipe de France et les États-Unis.
Quand on a le pied entre deux championnats, qu’on jongle entre deux visions du basket, est-ce que c’est facile de ne pas se perdre, de ne pas perdre pied ?
Les deux visions sont complémentaires. Il faut, selon moi, ouvrir ses chakras et aller voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir se compléter soi-même.
Personnellement, je ne pouvais pas me contenter uniquement de la formation française en me disant : « C’est ça, le basket ». Il me fallait aussi aller voir ailleurs.
Il se trouve que le basket est né aux États-Unis, j’avais envie de voir ce que c’était réellement, envie de revenir aux origines. Je ne me suis pas perdue, même si je ne l’ai pas fait chaque année parce que c’était intense.
En 2010, je n’en pouvais plus. J’ai commencé par la WNBA, je suis arrivée en équipe de France et j’ai fait un burn out. J’ai quitté les rangs. Ce n’était pas facile, il y avait le décalage horaire, cette pression en terme de responsabilité.
Cette année-là, j’étais joueuse cadre au Sun, joueuse cadre aussi en équipe de France et ça faisait beaucoup. Mentalement, c’était trop. À un moment, j’ai dit stop, je ne continue pas en équipe de France, je rentre chez moi.

Tu parviens, quoi qu’il advienne, à te poser des limites ?
Mon bien-être est important. Cette année, par exemple, j’ai reçu une offre de Seattle mais j’ai dit non, ce n’est pas possible. J’ai fait un choix, celui de durer jusqu’à 37 ans, et il faut que je réduise.
Je ne peux plus faire trois championnats à l’année. J’ai choisi l’équipe de France. Je décline des offres, aujourd’hui encore, par sagesse.
En 2017, dix ans après ton départ pour la Russie, tu reviens en France le temps d’une pige médicale à l’ASVEL. Toi qui as connu la ferveur des Russes et des Turcs pour le basket féminin, tu renoues avec un championnat beaucoup moins mis en valeur. Comment expliques-tu ce moindre intérêt pour le sport en France ?
C’est culturel. Certaines nations comme les États-Unis, la Turquie, ont misé sur le sport alors qu’en France, ça ne fait pas partie des priorités, tout simplement.
En Turquie, le basket tutoie le football de très près. Là-bas, tout comme en Russie, on voyage dans de grands bus floqués et on est escortées par la police pour aller faire un match.
Je ne cherche pas forcément à être escortée par la police à chaque match, c’est juste une réalité. Les gens ne se rendent pas compte de la manière dont nous sommes traitées là-bas. En France, en Italie, on se déplace en minibus, incognito. C’est un autre monde.
Ta carrière, prolifique, en club, se double d’un parcours très riche en bleu. Ta première cape en équipe première remonte à 2006 face à la Chine. Porter le maillot bleu était aussi une case à cocher dans ton plan de carrière ?
Pour moi, le maillot bleu c’est identitaire. On représente une nation, tout un peuple, c’est un message très fort. Je suis issue d’un circuit fédéral et j’ai toujours entendu ce discours.
Plus jeune, l’un de mes coaches nous avait expliqué que, plus on représentait des entités fortes, plus nos actes, nos agissements avaient une portée et des conséquences en proportion.
J’ai toujours compris, pris et embrassé la responsabilité qui allait avec ce maillot. Ça me plaît de me dire que je mets mon talent, mon savoir, au service d’une nation, d’un peuple. Ça, on ne le fait pas pour soi. Je joue parce que j’aime le basket, bien entendu, mais ce n’est pas la seule raison et celle-là me dépasse.
C’est pour ça qu’il était compliqué, pour moi, de choisir entre la WNBA et le maillot bleu. La WNBA se serait déroulée lors de la saison hivernale, j’aurais opté pour la WNBA au lieu de saisons en club à l’étranger mais, à choisir entre la WNBA et les Bleues, il n’y a pas photo.
Tu as pensé aussi à ton père quand tu as enfilé ce maillot pour la première fois, deux membres de la même famille, qui plus est père et fille, en EDF c’est assez rare ?
Oui, c’est marrant. Papa m’a toujours dit qu’il était fier de moi entre autre parce que je continuais quelque chose qu’il avait commencé. On est ensemble.
Il a débuté une aventure en bleu et je la poursuis. Nous n’avons pas deux carrières indépendantes mais une seule carrière à nous deux.
Trois ans après ta première sélection, c’est la consécration avec un titre de championne d’Europe à Riga en Lettonie. Quand tu évoques ton parcours en bleu, c’est ce titre qui semble te tenir le plus à cœur. Pourquoi ? Est-ce que c’est juste une question de couleur de médaille ?
C’est une question de couleur de médaille mais aussi de parcours. J’ai commencé en équipe de France en 2006 et, cette année-là, on termine 5e mondiales ce qui était une première.
L’année suivante, gros flop, on finit 10e. En 2008, il y a un tour qualificatif et je suis en WNBA ; en 2009, c’est la reconstruction. Lorsqu’on arrive au Championnat d’Europe à Riga, avec tout ce qui venait de se passer, les gens ne nous attendaient pas mais on crée la surprise et une belle surprise car on devient championnes d’Europe.
Ce moment est gravé dans ma mémoire car c’est le premier titre européen et, à ce moment-là, je pense que je peux en gagner plein d’autres… Sauf que ça ne s’est jamais reproduit.
À l’époque, j’avais 22 ans et moins de recul mais je me dis, aujourd’hui, que ça a été une leçon pour moi : il faut profiter de l’instant présent, ne pas faire de plans sur la comète car rien n’est jamais acquis.

Pourtant, des médailles en bleu, tu vas en décrocher sept autres : le bronze européen en 2011, l’argent européen en 2013, 2015, 2019 et 2021. Il y aura aussi deux médailles olympiques, l’argent à Londres en 2012, première médaille olympique pour un sport collectif féminin français, et le bronze en 2020 à Tokyo.
Il est clair, qu’après, il y a eu plein d’autres médailles mais je fonctionne par catégories. Si je ne regarde que les seuls championnats d’Europe, il y a trop d’argent !
Je sais qu’aux Jeux, je fais partie des seules basketteuses à collectionner deux médailles, j’ai conscience de mon parcours mais, en ce qui concerne les Europe, il y a un goût de pas assez.
Être compétiteur, c’est cultiver un sentiment d’insatisfaction. Je suis contente de mes performances, mais il y a toujours quelque chose à peaufiner. Je pense que je ne serai satisfaite que lorsque j’aurais raccroché.
Tu ambitionnes de raccrocher à 37 ans, en 2024 ?
Oui, pour moi il me reste deux ans, pas plus. Je n’irai pas au-delà de Paris 2024. J’aimerais pouvoir arrêter sur cette scène-là, la scène olympique, c’est mon rêve.
Est-ce que je vais pouvoir aller jusque-là physiquement ? Je ne sais pas, mais c’est ce que j’ai en tête : arrêter en France devant mon public.
Avec l’or autour du cou ?
Ce serait la cerise sur le gâteau, ce serait génial !
La suite, tu l’envisages comment ? De l’autre côté du banc ?
Coach ? Non ! Je dirai peut-être autre chose dans un an mais je ne me vois pas coacher une équipe de basket ou devenir coach privée.
En revanche, je me vois faire des conférences, des séminaires pour partager mon savoir, accompagner les gens, les aider à se structurer, intégrer les valeurs du sport dans l’entreprise, ce qui est, quelque part, une forme de coaching.
Tu es aussi engagée dans une association que tu as fondé en 2020, « Jeux et Enjeux »…
Pour arriver au très haut-niveau et durer, il faut pouvoir être alignée et cet alignement tête-cœur-corps est essentiel. Ce travail, je l’ai fait sur moi et je me suis dit qu’il fallait que les jeunes puissent, eux aussi, le faire, j’ai eu envie de le transmettre.
Mon association est basée en Martinique et propose du développement personnel juvénile à travers des stages destinés aux 13-17 ans. Je suis tellement contente !
C’est la deuxième édition mais, peut-être que plus tard, j’aurai une antenne à Paris. Pour le moment, je continue à prendre mes marques et à roder mon projet au mieux.
Peut-être qu’en terme de reconversion je me consacrerai entièrement à ça… ou pas ! J’aime toucher à tout, on verra !
D'autres épisodes de "Basketball : ces stars des parquets"