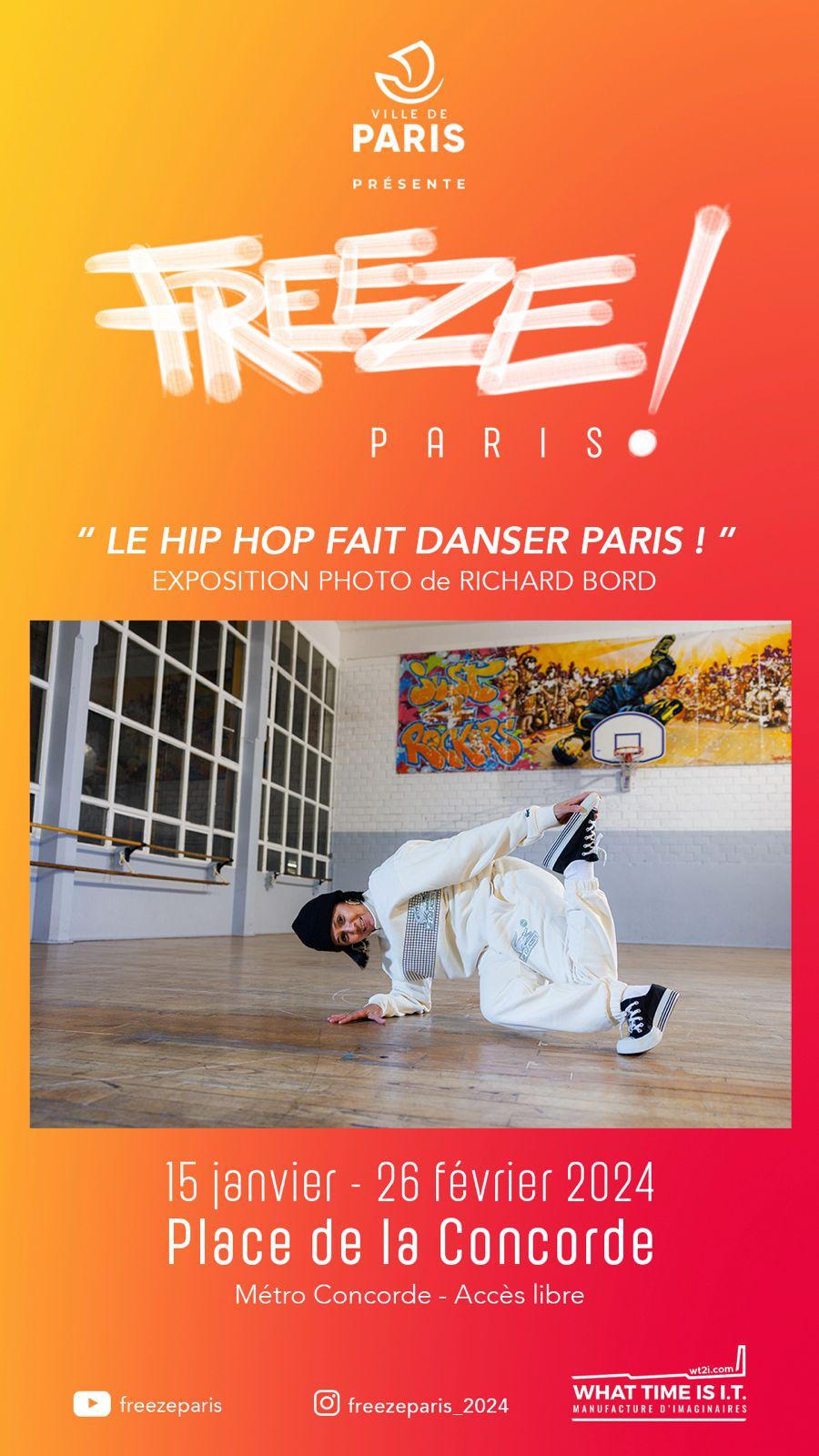Tu es une pionnière du breaking en France et pourtant ton parcours est très peu documenté. Tu as commencé à faire parler de toi en montrant de quoi tu étais capable aux Halles, ton terrain de jeu, lorsque tu avais une petite vingtaine d’années. Comment se sont passés tes débuts ?
Je viens de province, mes parents sont Algériens et j’ai grandi à Chambéry. À 20 ans, j’ai voulu aller à Paris parce que j’avais la danse en tête depuis des années – la danse hip hop et le break, plus particulièrement – et j’ai commencé à parcourir la ville et le pays.
À cette époque, j’avais déjà commencé à voyager à Londres, à New York à la recherche de connaissances sur le sujet car l’accès à l’information n’était pas le même que maintenant. Il reste, il est vrai, que mon parcours est peu documenté parce qu’il est atypique. J’ai beaucoup de mal à parler de moi, à mettre en avant ce que je fais parce que j’ai toujours peur de trahir les valeurs de cet art.
Le hip hop est une culture authentique ou du moins qui cherche à la rester et cette authenticité est très importante à mes yeux, c’est un héritage que je ne veux pas trahir.
Paris représente quoi dans ton parcours de danseuse ?
Paris, c’est là où je me suis émancipée, là où j’ai grandi. C’est aussi dans cette ville que j’ai énormément appris parce c’est là qu’était la culture hip hop. En province, c’était très compliqué : tu étais vite marginalisée parce que tu écoutais du rap. Moi en plus, j’étais d’origine nord-africaine, musulmane, une meuf… ça faisait beaucoup. Je cochais toutes les cases associées aux stéréotypes des filles de la cité sauf que, je n’ai pas grandi en cité !
À partir du moment où je suis arrivée à Paris, j’ai commencé à voguer partout, j’ai commencé à voyager aussi, le plus souvent seule : je n‘étais pas affiliée à un groupe, j’étais plutôt un électron libre et même si l’on a souvent voulu me prendre dans des groupes, j’ai toujours gardé cette autonomie à 100 %.
Comment as–tu découvert la discipline et qu’as-tu ressenti ?
J‘ai découvert la discipline à travers les écrans, par la télé, à travers la musique aussi grâce à des chanteurs comme Michael Jackson, Janet Jackson, tous ces artistes qui flirtaient avec le hip hop à cette époque. Et puis, j’avais des grands frères dont l’un, surtout, écoutait beaucoup de musique noire–américaine, c’est à travers ça que tu rentres dans la culture, que tu apprends.
Il y avait aussi le quartier, parce que c’est là que le hip hop a grandi et puis, par la suite, des gars, des pionniers, sont venus dans notre ville et ont commencé à donner des cours. Peu à peu, j’ai eu accès à toute cette culture et j’ai commencé à danser en 88.
Il y avait également une émission appelée « H.I.P, H.O.P, » et animée par Sidney, elle t’a influencée aussi ?
Oui, j’étais jeune, j’avais 9 ans. Je m’en souviens parce qu’à l’époque, j’étais chez mes grands-parents et j’habitais avec eux à Toulon, dans le sud de la France. Dans cette émission, il y avait un gars qui s’appelait coco et toute la ville était derrière ce mec-là.
Est-ce que l’on peut parler de sport ou est-ce que le break dépassait ce cadre et se rapprochait plus d’une forme de revendication pour toi, une manière de montrer à tous que ce mouvement existait, de montrer ce que vous étiez capables de faire ?
Il y a toujours eu une histoire de revendications même si, plus jeune, on ne le formalisait pas comme ça. Ça a été tout un cheminement, une réflexion mais, malgré tout, dès le départ, tu sentais une sorte de rébellion dans cette musique. Je ne comprenais pas encore bien l’anglais mais on savait qu’il y avait un truc de cet ordre-là, quelque chose d’émotionnel, qui te prenait aux tripes.
Tout cela faisait que le breakdance n’a jamais été du sport mais un moyen de communication entre des communautés, entre des gens, des groupes de personnes. Le hip hop a été un mouvement et ce qui était bien avec ce mouvement, c’est qu’il regroupait différents modes d’expression artistique et selon tes centres d’intérêt, tes habilités tu pouvais dire : « Moi, c’est la danse qui m’intéresse ou moi, c’est la musique qui m’intéresse ».
Quoi qu’il en soit, c’était le package qui était intéressant, le lifestyle aussi, la manière dont les gens le vivaient.
Qu’est-ce que cela signifiait pour toi à l’époque ?
Moi, j’ai toujours été très très rebelle, rebelle par rapport à la société. Mon père était aussi quelqu’un de très engagé, il s’intéressait beaucoup à la géopolitique notamment et pour moi, toute cette injustice dans le monde, ce n’était pas normal : pourquoi l’apartheid, les immigrés, les enfants d’immigrés… J‘avais toujours ce sentiment de révolte en moi et c’est aussi pour cela que cette culture me parlait énormément.
Les filles étaient malgré tout rares dans ce milieu, est-ce que ça a été facile t’imposer ce choix à ta famille ?
Mon père ne nous a jamais empêchés de faire du sport, il était lui-même très sportif et pratiquait la boxe, le cyclisme…. La chance que j’ai eue, c’est que j’ai choisi une danse un peu masculine, disons ça comme ça, ce qui fait qu’il n’était pas question de sensualité, il n’y avait pas besoin de s’habiller de façon girly alors ça passait crème.
Mon père voyait le côté sportif et comme – il m’a quand même laissée faire et, de mon côté, je suis restée très mystérieuse, très discrète par rapport à ça. Je crois que, même encore maintenant, il ne sait pas trop ce que je fais. Quand je voyage, il me dit : « Mais attends, tu n‘as pas fini avec ce truc ? Tu as des enfants pourtant maintenant ! ».
Et vis-à-vis de l’extérieur, des pratiquants ?
Je n‘ai jamais tout raconté à mes parents parce que sinon, en réalité, ils n’auraient jamais accepté que je pratique : à l’époque, tu allais dans les caves, dans les MJC où il n’y avait que des mecs, pareil pour les centres socioculturels. Approcher des lieux comme ceux-là pour faire du sport ou de la danse était quasiment impossible pour nous, les filles. C’étaient les mecs qui y avaient accès, ils étaient en majorité et, en plus de cela, ce n’était pas très bien vu d’aller dans des groupes de mecs.
Ça renvoyait quelle image une fille qui pratique le break?
Ça signifiait que tu n’étais pas une fille de bonne famille comme on disait. En plus, moi j’adorais mettre des pantalons un peu larges, des bérets, des casquettes, et tout cela mis l’un de l’autre me marginalisait au regard des autres.
Ma mère me disait : « Mais arrête de mettre ce chapeau, tu nous fous la honte ! » parce que, vis-à-vis de la communauté nord-africaine, je détonnais totalement.
Comment est-ce que tu es parvenue à faire ta place ?
Je me suis dit que j’avais réussi à m’imposer aux yeux de ma famille et si mes parents étaient ok avec ce que je faisais, je n’allais pas demander l’autorisation aux autres. J’avais l’impression que je faisais tellement de sacrifices pour pouvoir faire ça !
Moi, je rêvais de pouvoir danser tout le temps mais ce n’était pas possible, ce n’était pas dans les plans. Mon père rêvait de me voir médecin, j’ai fait une année de médecine avant de me réorienter vers une école d’infirmière parce que j’étais trop happée par la danse mais je savais qu’il fallait que j’aille au bout de mes études et que j’obtienne mes diplômes pour qu’on me fiche la paix.
Je faisais un milliard de choses en même temps. Quand je suis arrivée à Paris, ça a été une bouffée d’oxygène mais j’ai trouvé le milieu un peu plus hostile, plus dangereux, plus agressif.
À un moment, j’ai dansé avec une compagnie contemporaine, la compagnie Montalvo–Hervieu et il y avait des gars qui m’empêchaient d’aller dans ma loge, on essayait de me mettre la pression. Et puis parfois, on allait dans des lieux où il fallait faire attention avec des mecs saouls, des lieux où tu peux te faire emmerder.
En parallèle, il y avait le milieu hip hop avec des types souvent plus âgés que moi et pour qui tu n’étais qu’une meuf. À cette époque, une meuf ça veut dire que soit tu es pute et là, tu es tranquille mais personne n’a de respect pour toi, soit tu es la meuf d’un danseur et, dans ce cas-là, tu restes sage et tu n’as pas ton mot à dire.
Nous les danseuses, on n’était peu nombreuses. Heureusement pour moi, je n’ai jamais eu peur, je ne me suis jamais laissée impressionnée. Pour moi, tout ça était une injustice et j’avais toujours envie de challenger ces gars. Pour autant, même si c’est un milieu masculin, il ne l’est pas plus qu’un autre mais il n’empêche que j’ai toujours gardé mes distances, et émotionnellement, et physiquement, et c’est ce qui m’a protégée. On ne pouvait pas m’approcher et on respectait ma façon d’être.

La passion de la danse est tellement forte que tu es prête à tout endurer. C’était vital de danser pour toi ?
Oui, c’est ça, tu as tout dit. Ce qui est vital, c’est respirer, boire et manger et, pour ma part, tu rajoutes danser. Je ne sais pas ce que je recherchais à travers la danse, il faudrait que je me lance dans une psychanalyse, mais, encore maintenant, il m’arrive de me demander pourquoi je me suis lancée là-dedans. À bien y réfléchir je pense que c’est un tout qui me nourrissait et me nourrit encore, un tout dans lequel je me suis énormément investie.
Contrairement aux danses, disons classiques, le break peut s’apparenter à un mouvement plus spontané qui évolue par et à travers ceux qui le pratiquent. Comment as–tu appris ? Sur le tas, à travers les vidéos ?
Oui, c’est ça. Il faut explorer ton corps, te rendre compte de tes capacités. Le fait d’être infirmière m’a aussi beaucoup aidée à ne pas me faire mal, à ne pas me blesser. Pour le reste, tu apprends en autodidacte.
Il y a plusieurs courants dans le break en matière de type de danse et d’esthétique, c’est pour cela que, pour moi, c’était avant tout une démarche individuelle. Tu pouvais trouver des gars pour t’apprendre mais, moi, j’ai toujours refusé les mentors, j’ai aussi toujours été partagée à l’idée de rentrer dans un groupe sauf à en créer un, le mien. Et puis rentrer dans un groupe n’était pas si facile, il fallait montrer patte blanche, être « sympathique » et moi je n’étais pas prête à cela.
J’ai appris seule, beaucoup, mais j’ai eu aussi de la chance parce que j’ai eu des gens autour de moi, des gens que j’ai choisis, qui m’ont aussi beaucoup apporté. Je dansais pour moi, je ne recherchais que ça, pas la notoriété.

Au début des années 2000, la culture hip hop connait un tournant. Underground à ses débuts, elle devient culture émergente et va commencer à s’imposer un peu partout dans le pays : le rap passe à la radio, les galeries d’art commencent à exposer des œuvres de street art, des spectacles de break vont être programmés notamment à La Villette. Comment l’as-tu vécu ce tournant, comme un début de reconnaissance ?
Pas du tout ! j’ai trouvé au contraire que, plus ça devenait populaire, moins il y avait de reconnaissance. Lorsque tu passes de lieux underground à des lieux comme La Villette, des monsieur et madame tout le monde sont propulsés d’un coup experts en la matière. Ce sont des fans de hip hop certes, mais qui n’ont ni l’expertise, ni l’expérience, des gens qui n’ont pas vécu ce que l’on a vécu, qui ne l‘ont pas senti, ressenti.
Le fait de mélanger ces deux mondes m’a donné l’impression qu’il fallait revoir notre discours parce qu’il fallait que l’on s’adapte à un nouveau monde, un monde qui voulait le bien de notre art mais qui ne voulait pas entendre parler de là où il était né. Il fallait polir le mouvement. Ces institutions-là, celles qui se sont accaparé le mouvement, ne font pas appel à nous, ceux que j’appelle les vrais gens car on est chiants, on défend nos valeurs.
En parallèle de ça, il y a eu une nouvelle esthétique qui a commencé à émerger dans le break, très acrobatique, plus axée sur le mouvement et moins sur la danse et je m’y retrouvais moins.
Le gain de popularité du hip hop, la reconnaissance, va avec l’argent. On a la sensation que le break des débuts y a laissé un peu de son âme, de sa richesse.
Il faut bien reconnaitre qu’il y a des avantages et des inconvénients à cette popularité soudaine, mais je ne suis pas très sûre que ce soient ceux qui ont créé, bâti ce mouvement qui en profitent le plus.
Tu n’as jamais réussi à en vivre ?
Je n’ai jamais voulu en vivre. J’ai un niveau professionnel mais je n’ai jamais voulu en faire de façon professionnelle, à savoir gagner mon argent grâce à ça. Je suis infirmière, j’ai un cabinet, j’adore mon métier et même si je suis toujours très investie dans la danse, j’avais peur qu’en en faisant mon activité principale, ça coupe ma parole.
Les gens aimaient ce qu’on faisait, on nous trouvait fabuleux mais il fallait que l‘on reste à notre place. Nous, on venait de la rue, on était pour beaucoup issus de l’immigration et on venait du même milieu social, un milieu modeste. Je ne voulais pas être censurée et l’argent te censure car, si tu n’es pas contente et tu le dis, tu risques de ne pas pouvoir manger. C’est ce qui, je trouve, a perdu notre milieu : on s’est monétisés mais pas assez pour être décisionnaires. Quand tu n’es pas décisionnaire, même si c’est toi qui danses, tu restes toujours à la merci de quelqu’un.
Est-ce que, malgré tout, tu as toujours réussi à t’y retrouver ?
Je réussis toujours à m’y retrouver parce que je me focalise sur ce que j’aime. Je n’oublie pas les raisons qui m’ont fait aimer la danse et c’est pour ça que je suis toujours présente et active. Et puis le hip hop a une caractéristique qui lui est propre, c’est qu’il évolue constamment, il se transforme, il s’adapte et nous aussi. Il y aura toujours des niches dans lesquelles on va pourra rêver, s’éclater, créer.
Comment s’est passé la suite de ton parcours ? Tu as monté une association, Positive Events*, par le biais de laquelle tu dispenses des cours de breaking, tu es jury dans de nombreux contests…
Je viens d’achever une création pour un théâtre à Zurich, en Suisse, sur la thématique des danseurs et de l’âge. J’oscille entre différents projets, je fais aussi beaucoup de jury partout dans le monde. Je fais partie des quelques juges internationaux français, je vais aux Asian Games en Chine et il est possible que je puisse officier aux Jeux Olympiques de Paris 2024 mais je ne sais pas encore.
La présence du break aux Jeux Olympiques est une évolution qui fait sens pour toi ?
Oui, dans le sens où il était obligé qu’on en arrive là vu l’essor et la popularité croissante du break ou le hip- ces dernières décennies. C‘était presque une évidence. Ceci étant, le break, tu ne peux pas le dissocier du hip hop mais c’est ce qui est arrivé ces dernières années, on s’est sectionnés. Ça a commencé par le rap, puis le graffiti et nous, nous étions les seuls qui restions encore dans la rue, les derniers détenteurs de l’authenticité de cette culture.
Le fait que le break arrive aux Jeux Olympiques c’est un peu le début de la fin, on va se couper de cette culture dans sa globalité.
D’autres disciplines ont eu le même questionnement, le skate notamment. Certains y ont vu un bénéfice, celui d’ouvrir la porte aux filles car, pour être présents aux Jeux, il faut autant de représentants hommes que femmes. Est-ce que le break avait besoin de ça ?
Non, je pense que l’on n’avait pas besoin de ça. Nous, les filles, nous avons largement pris notre place et pourtant nous évoluons nous aussi dans un milieu très masculin. Mais cette question de place pour moi, ce n’est pas celle des filles dans les battles mais celle des filles parmi ceux chargés de prendre des décisions. Pour moi, il y a là un combat à mener pour les femmes.
Quand tu regardes la commission de break, elle est composée à 99 %, pour pas dire 100 %, de mecs. Qu’est-ce qui change pour nous avec les JO ? Même pour entraîner des filles, ils prennent des mecs et pour entraîner des mecs… et bien ils prennent des mecs !
Si tu devais réfléchir à ce que tu as apporté au mouvement, tu dirais quoi ?
C’est très compliqué. Je ne dis pas que j’ai apporté quelque chose, j’ai simplement soutenu cette culture. Ou alors, si j’ai apporté quelque chose, ce serait peut-être une absence de langue de bois en osant poser des questions gênantes propres à la danse comme les formats, la condition des danseurs… J’ai aussi apporté un soutien inconditionnel à cet art et à ceux qui sont dedans. J’ai beaucoup transmis à travers mon association notamment.
Artistiquement, au niveau de ma danse, c’est aussi ça mon apport, j’avais une touche particulière dans le break, une façon très dynamique de breaker que l’on ne voyait pas beaucoup chez les filles au début, elles étaient plus lentes.
J’ai aussi commencé à faire des phases, des power moove et j’ai beaucoup représenté la France dans le monde entier. J’ai toujours essayé de mettre mon pays sur la carte du monde.
*Retrouvez l’association de Nacéra Guerra, Positive Events, sur sa page Facebook