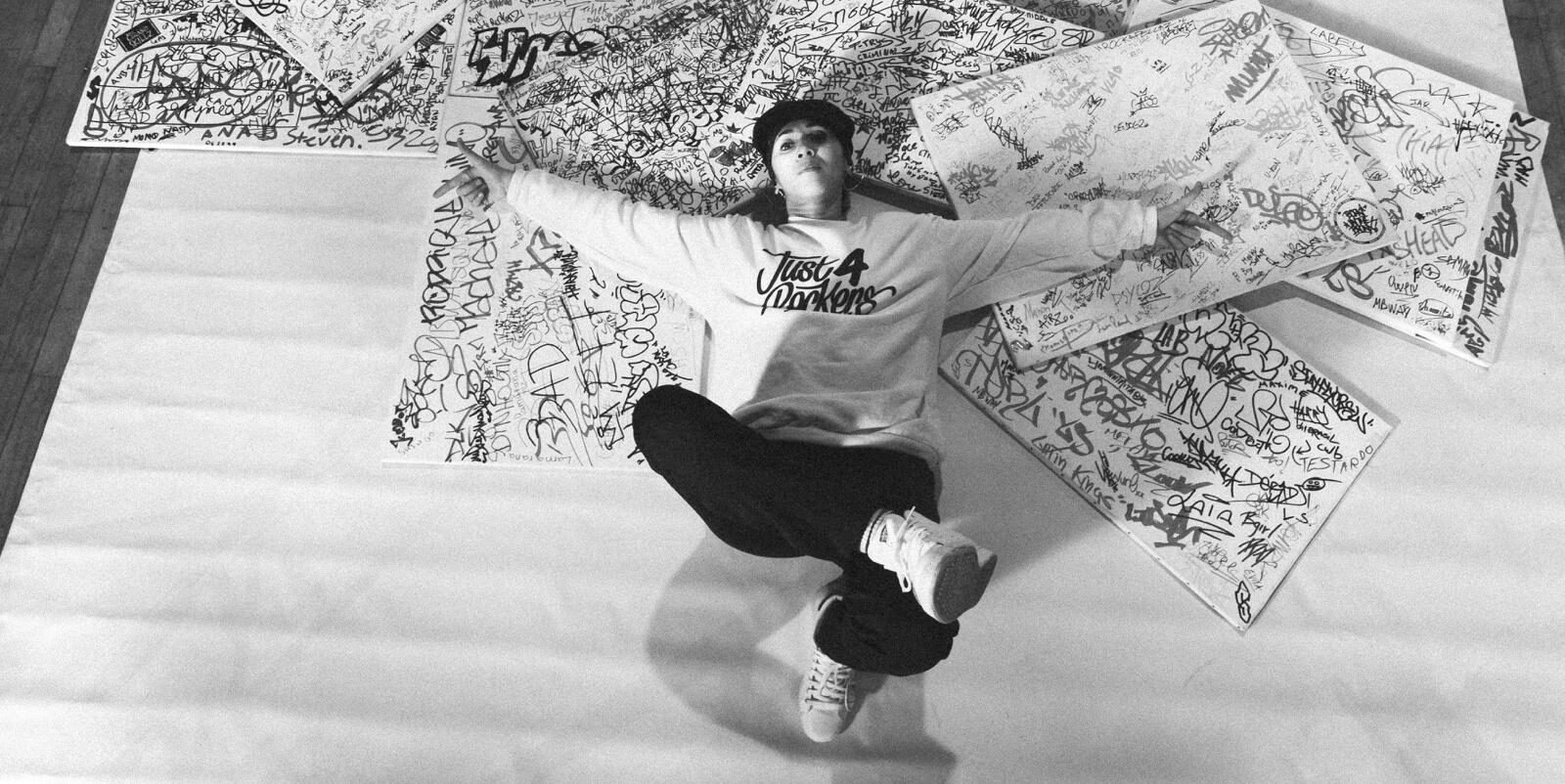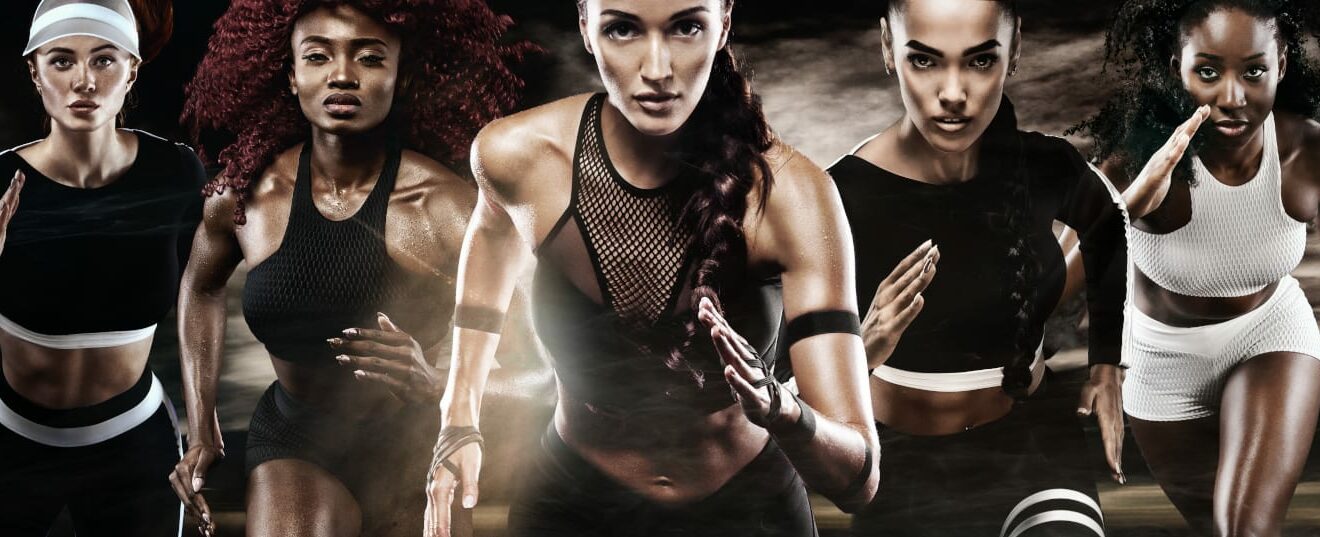Dans l’épicentre du monde sportif, là ou idéal méritocratique et compétition se conjuguent, émerge une réalité souvent occultée : harcèlement moral et maltraitances.
En effet, ces dernières années ont été marquées par des scandales qui ont ébranlé le monde du sport, révélant non seulement des cas de violences sexuelles, mais également des pratiques d’entraînement autrefois acceptées. Ces entraînements caractérisés par des humiliations, des manipulations psychologiques, voire des actes de violence physique, font désormais l’objet de dénonciations de la part de leurs victimes, marquant ainsi une révolution (lire le témoignage de la championne d’aviron Clara Valinducq).
À titre d’exemple, Vincent Plateau, le directeur technique du pôle France de gymnastique de Marseille, a été condamné en mai 2023 à six mois de prison avec sursis pour de tels agissements.

Clara Valinducq… ©FFAviron/Lionel Piquard
Le harcèlement moral peut se manifester par des mises à l’écart, des propos insultants, menaçants, des comportements humiliants, ou des pressions insupportables. En vertu de l’article L. 1152-1 du code du travail, il est nécessaire que ces comportements se répètent, de manière persistante. Ceux-ci doivent entraîner une détérioration de l’environnement de la personne concernée et porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
Aussi, l’article 222-33-2 du code pénal prévoit que le harcèlement moral constitue un délit, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Dans ces conditions, la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 parue au Journal officiel du 3 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France prévoit l’insertion de l’alinéa suivant à l’article L. 100-2 du Code du sport qui aborde ces violences :
« Ils [l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales] veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. »
Malheureusement, ces dispositions législatives peuvent parfois être perçues comme de simples déclarations d’intention, car la reconnaissance effective du harcèlement moral dans le milieu du sport de haut niveau demeure, encore aujourd’hui, particulièrement complexe.

Ces difficultés sont principalement associées au contexte inhérent au domaine sportif, caractérisé par une culture axée sur les résultats et un niveau élevé de stress. Cependant, bien que cela soit un sujet distinct, il est important de noter que ces méthodes ne paraissent plus en adéquation avec la préoccupation croissante des athlètes vis-à-vis de leur bien-être mental.
En tout état de cause, lorsqu’une affaire implique le cas d’un harcèlement moral d’un sportif, le juge s’efforce d’éviter toute confusion entre les notions de harcèlement moral et le pouvoir de direction de l’entraîneur. En effet, à l’image de l’employeur en droit social, l’entraîneur exerce une autorité exclusive sur l’organisation de la pratique sportive de l’athlète et les modalités de sa mise en œuvre. Par conséquent, ses décisions prises dans ce cadre ne peuvent être qualifiées de harcèlement.
Dans ce contexte, en 2014, un joueur de handball avait introduit une action devant le conseil de prud’hommes, alléguant être victime de harcèlement moral. L’athlète dénonçait des agissements répétés, se manifestant par une conduite abusive, des paroles et un comportement dévalorisant de la part de son entraîneur.
La Cour d’appel de Versailles a néanmoins écarté la qualification de harcèlement moral, replaçant les faits dans le « contexte hors norme » que constitue le milieu sportif. Pour elle, l’environnement sportif présente d’inévitables confrontations liées aux défis physiques qu’il implique et pourrait ainsi « naturellement » lieu à l’adoption de modes de communication virulents (CA Versailles, 23 janvier 2014, n° 13/00608).

Dans cette affaire, la Cour retient que les agissements reprochés à l’entraîneur n’étaient en réalité que « l’expression de la nécessaire pression mise en œuvre par l’entraîneur », équivalente à l’exercice normal du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, pour motiver son équipe, améliorer ses techniques de jeu et la mener jusqu’à la victoire convoitée.
Cependant, malgré une telle culture jurisprudentielle, des progrès sont en cours, comme en témoigne récemment l’adaptation du concept de placardisation au domaine du sport professionnel. En effet, la Cour de cassation a récemment affirmé que le fait de priver une équipe de joueurs de toute participation aux matchs pendant une période prolongée pouvait constituer une atteinte à leur dignité (Civ. 2e, 18 févr. 2021, n° 20-12.013, MONTVALON, La placardisation. Réflexions juridiques sur le non-travail forcé, Dr. soc. 2023. 443).
Quoi qu’il en soit, et malheureusement, la persistance de la culture du silence dans le milieu sportif représente un obstacle majeur à la prévention du harcèlement moral.
Afin d’inverser ces tendances, l’instauration d’une culture préventive du harcèlement dans le milieu sportif constitue un changement significatif dans la façon dont ces acteurs traitent les problématiques de violence et de discrimination.
Ainsi, depuis l’adoption de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 précitée, une dimension juridique nouvelle et indispensable à la lutte contre le harcèlement est intervenue.

Cette transition trouve notamment son ancrage au niveau national par la mise en place de commissions d’éthique et de déontologie au sein des fédérations. Ces instances ont pour mission de définir des normes précises et de superviser la mise en œuvre de mesures préventives, instaurant ainsi un cadre juridique formel contre le harcèlement dans le contexte sportif.
L’obligation faite à chaque fédération de désigner au moins un référent, comme le stipule la loi de démocratisation du sport, accentue également la dimension légale de cette transition. Ces référents sont désormais les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics sur les questions de harcèlement, contribuant ainsi à une application plus rigoureuse des dispositifs de prévention.
Aussi, la responsabilisation des acteurs locaux, soulignée par les conférences régionales du sport, permet la formalisation de projets territoriaux, conformes à l’objectif de la loi de 2022 et vise à prévenir et à lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations. Dans ce cadre, les clubs sportifs sont tenus à une obligation générale de sécurité dont le non-respect peut entraîner l’engagement de leur responsabilité juridique (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-17.904 : JurisData n° 2018-008269).
En résumé, la culture préventive du harcèlement moral dans le monde du sport, catalysée par la loi de 2022, s’enracine progressivement dans des dispositifs juridiques contraignants. Cette évolution vise à instaurer des pratiques sportives respectueuses et équitables, encadrées par des normes légales rigoureuses.
*Anne-Andréa Vilerio est avocate en droit public au barreau de Paris, spécialiste du droit du sport. Membre de l’association Femix’Sports qui s’engage pour la valorisation du sport féminin, elle propose, dans ses chroniques pour ÀBLOCK!, un éclairage juridique sur l’actualité et la place des femmes dans l’univers sportif.
Ouverture ©Pexels