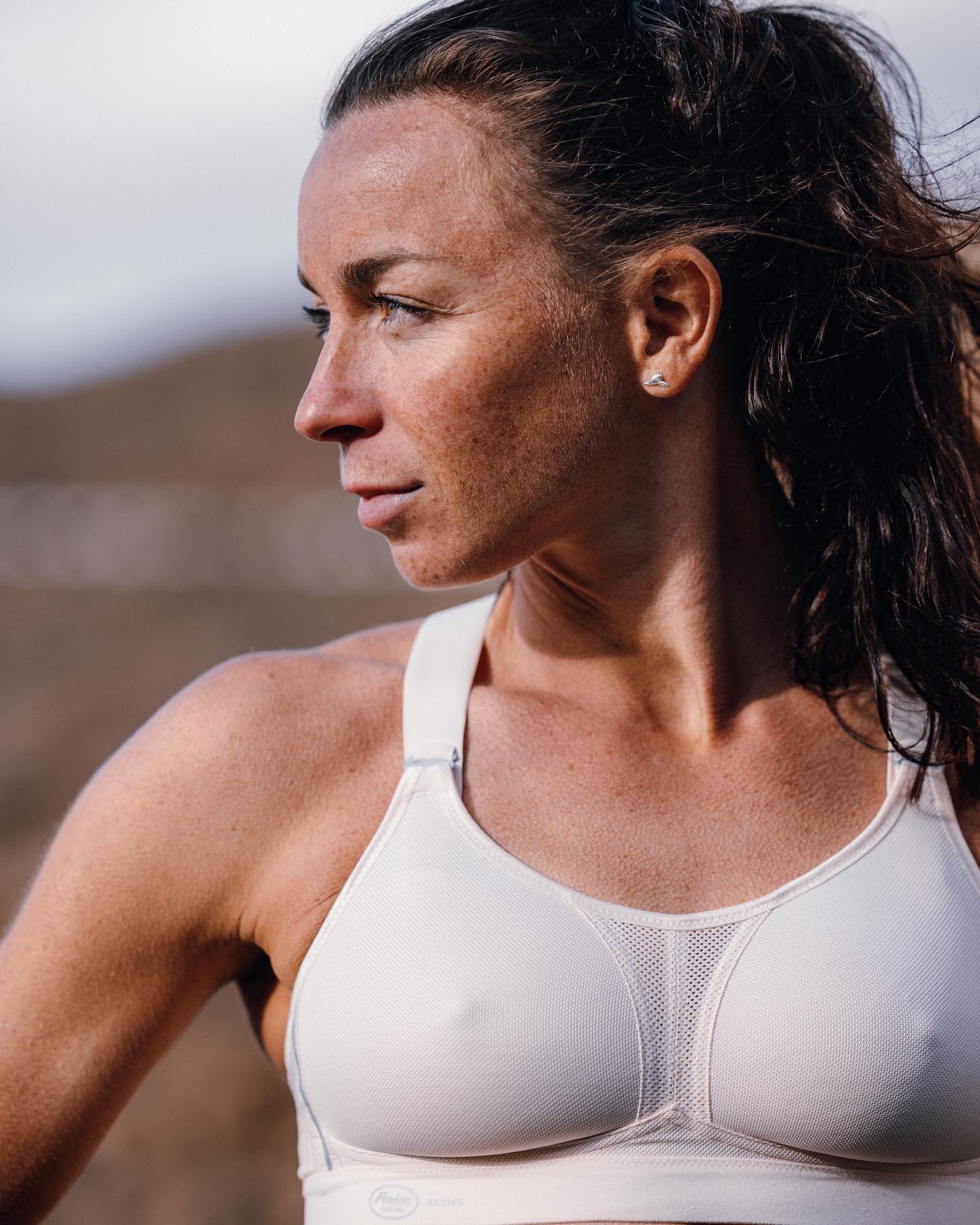Aujourd’hui, tu es à fond dans le triathlon mais, enfant, c’est une autre discipline qui t’attirait…
Oui, la gymnastique. Ça a été ma première passion, mon premier sport. J’ai commencé à 7 ans et j’ai arrêté à 17 ans. Dix ans de gymnastique artistique en sports-études. C’était une grosse implication, il y avait entre dix et quinze heures d’entraînements par semaine.
J’ai commencé la course à pied après avoir arrêté la gym.
Pendant cette période, quel était ton rapport à ton sport ? Compétitif, loisir…
À la base, mes parents m’ont demandé de choisir un sport dans lequel je serais pleinement investie. C’était important pour eux. Il fallait que je n’aie pas trop de temps morts, que le temps extra-scolaire soit mis à profit avec une autre activité.
C’est comme ça que j’ai fonctionné avec la gym. Dans ce sport, on ne peut pas vraiment faire juste du loisir. J’avais quelques qualités et j’ai très vite été orientée vers la compétition, même si ce n’est pas forcément ce que je voulais.
J’aimais la compét’, mais pas en gym. J’ai très vite détesté ça même. Je n’étais pas mise en confiance, c’était à contre-cœur que je participais aux concours.
En revanche, il y avait toujours cette notion de performance que j’aimais beaucoup. Le fait de me dépasser, de gérer ma peur, la maîtrise de mon corps dans l’espace… Il y avait beaucoup de choses que j’aimais et que j’allais chercher à l’entraînement, mais je n’exploitais pas ça en compétition.
C’était comme un pilier pour moi, la gym. C’était un environnement dans lequel je me découvrais, dans lequel j’avais des liens amicaux… Mais malgré tout ça, ce n’était pas hyper positif, c’était un cadre dur.

Quand tu as commencé la course à pied, comment ça s’est passé ? Tu avais le même rapport qu’avec la gymnastique ?
J’ai arrêté la gym lorsque mon corps a commencé à changer. À cette période, c’était forcément plus difficile d’évoluer dans la discipline et je me voyais régresser. C’est pour ça que j’ai stoppé, je ne voulais pas avoir une pratique régressive, la performance restait importante pour moi. Et puis, j’avais perdu mon intérêt pour ce sport, je n’avais plus de nouveau challenge.
Je me suis donc mise à la course à pied. À la base, c’était uniquement pour garder une activité physique, dépenser mon énergie, garder un contact avec le sport. Il n’y avait pas vraiment de notion de performance.
En fin de compte, ça ne m’a pas suffi, je sentais bien qu’il me manquait quelque chose. Mais ça a tout de même était une période de transition.
J’ai essayé le triathlon quelques mois au club de La Rochelle, puis je suis partie toute seule aux États-Unis à mes 18 ans pendant une année. C’est là-bas que j’ai fait de la natation, que j’ai développé mon vélo…
En revenant, ma passion pour le triathlon était devenue plus forte.

Qu’est-ce qui t’as attirée dans le triathlon ?
Ce que j’aimais beaucoup, c’est qu’à l’image de la gymnastique, il y avait plusieurs disciplines dans un même sport. Ça demande de développer pleins de qualités différentes, ce n’est pas rébarbatif. J’ai toujours besoin de varier, j’aime ça !
Ce qui m’a plu aussi dans le triathlon, c’est la notion de l’enchaînement. Ce n’est pas véritablement trois disciplines. Mises bout à bout, elles forment réellement un sport. On n’est ni des coureurs, ni des nageurs, ni des cyclistes, on est des athlètes qui performent sur ces trois terrains mis bout à bout.
Et la notion d’endurance, d’extrême, me plaisait beaucoup également.
Une pratique-passion qui ne t’a pas fait tourner la tête. Tu es restée studieuse, en faisant une prépa littéraire puis une école de commerce…
C’est ça, j’espérais accéder à Sciences Po mais, finalement, j’ai fait l’école de commerce de Toulouse.
Les études ont toujours été la priorité pour moi, le sport venait en complément. Je ne m’étais jamais imaginée pouvoir faire du sport un métier.
D’ailleurs, tes débuts en triathlon sont en amateur, justement pour te consacrer à tes études puis ton travail qui restaient tes priorités…
Oui, en 2012-2013, j’ai commencé à un peu plus toucher au triathlon. Mes premières courses arrivent en 2013, mais c’était vraiment un loisir. J’avais même du mal à m’inscrire aux compétitions ! C’était une approche très « amateur ».
Est-ce que tu as commencé progressivement ou tu es tout de suite partie sur des plus longues distances, dans l’endurance, dans l’extrême comme tu disais ?
Je présentais des qualités d’endurance qui étaient indéniables. C’est mon entraîneur de l’époque qui m’a dit que ça ne servait à rien de faire du court et qu’il fallait partir tout de suite sur des plus longues distances. Ça a été assez naturel comme choix.
J’avais plus de plaisir à l’entraînement à travailler sur du long et j’avais plus de qualités pour ça.
Ce que j’ai particulièrement aimé, c’est qu’en découvrant les longues distances, j’ai aussi découvert toutes les ressources auxquelles on pouvait faire appel en tant qu’humain, physiques ou mentales.
Ça m’a vraiment fait accrocher. D’ailleurs, c’est encore ce qui me maintient dans ça aujourd’hui, c’est un puit de connaissance sans fond. On a toujours quelque chose à apprendre, c’est la clé de la performance sur la longue distance.
On ne peut pas tout maîtriser, mais il faut tout de même connaître beaucoup de choses sur son fonctionnement, la façon dont on se comporte… Le triathlon, ça t’apprend qui tu es.

En 2017, tu deviens professionnelle dans le triathlon. À quel moment ton sport est-il devenu ton projet pro ?
Quand j’ai eu mon diplôme en école de commerce, pour moi, la suite logique, c’était de trouver un CDI dans une boîte. C’est ce qui s’est passé, j’ai été responsable marketing… Et en parallèle, je continuais l’entraînement comme je l’avais toujours fait. Je cherchais peut-être un peu plus la performance, mais ça restait un « à-côté ».
Mais, pendant ces deux années-là, en 2015-2016, je me suis rendu compte que quand je me levais, je ne pensais qu’à mon entraînement. Il y avait bien sûr mon travail, mais toute mes journées étaient construites autour de mes entraînements. Il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là.
J’ai aussi fait quelques résultats en compét’, même s’il n’y avait pas beaucoup de concurrentes et que le niveau n’était pas super élevé. C’était des courses régionales, nationales éventuellement, mais je n’avais pas d’étoiles dans les yeux non plus.
Pourtant, je me suis dit que si je ne testais pas cette histoire de triathlon professionnel, je le regretterais toute ma vie. Et je n’ai pas du tout envie de me réveiller à 50 ans à me dire que j’aurais dû essayer ! Je ne voulais pas avoir de regrets.
Et là, j’ai commencé à étudier le projet de professionnaliser ma pratique sportive.

Comment t’es-tu préparée à devenir triathlète professionnelle ?
J’avais déjà la chance, à l’époque, de vivre avec Frédéric Lureau, qui est toujours mon entraîneur. On a monté ce projet à deux, en essayant d’être stratégiques et d’établir un plan.
On a regardé comment fonctionnait le triathlon longue distance, les sources de revenue, sur quelles courses je pourrais performer, quels moyens il allait falloir mettre sur la table pour que je performe…
Notre plan se basait sur des rêves. En face, on a mis des objectifs et pour viser ces objectifs, on a mis des moyens.
Je pense que mes études m’ont beaucoup aidée pour travailler sur ce projet, à le conceptualiser, à le rendre concret. Et une fois qu’on avait mis bout à bout tout ce dont on avait conscience, j’ai expliqué à mon patron de l’époque ce que je voulais faire et il l’a accepté.
C’est comme ça que je me suis préparée, en faisant un plan et en essayant d’être la plus pertinente possible dans tous les paramètres dont j’avais conscience.

Aujourd’hui, tu as toute une équipe qui t’accompagne. En plus de ton coach principal, Frédéric Lureau, tu as un entraîneur en natation, un kiné, une préparatrice mentale, un micro-nutritionniste… Ça faisait tout de suite partie du projet de t’entourer de la sorte ?
Pas vraiment, non. J’ai posé dès le début qu’il fallait que je sois capable de tout faire toute seule. Le triathlon reste une discipline où il y a peu d’argent. Je n’allais donc pas investir dès mes débuts, j’avais juste deux ans d’activité professionnelle derrière moi, c’était mince.
Je savais que la clé aller être de m’entourer, mais je savais également que ça viendrait plus tard. Il a fallu que j’apprenne à tout faire. J’ai monté mon auto-entreprise, j’ai appris un maximum de choses sur les statuts, l’administratif, le fonctionnement du corps, un peu de kiné, de la prépa mentale, de la nutrition, du matériel…
Tout ça, on l’a bossé à deux, au fur et à mesure des expériences, en ne cessant jamais de travailler… C’était la base, il fallait que je puisse me débrouiller seule en attendant de pouvoir déléguer cette charge de travail à des personnes compétentes.

Après ton passage en pro, les résultats suivent rapidement. En 2018, tu remportes deux Ironman 70.3 (les distances classiques d’un Ironman sont divisées par deux dans ces courses, Ndlr) à Nice et au Pays d’Aix. Ces victoires ont dû avoir une saveur particulière, tes premiers succès en tant que triathlète pro…
Oui, c’est vrai. Encore aujourd’hui, ces résultats ont vraiment de la valeur, j’avais réussi de belles performances. Mais pour autant, ce qui fait ma force, c’est de ne jamais me reposer sur mes lauriers.
Quand on se lance dans une carrière sportive, il n’y a jamais rien d’acquis. Le plus dur, ce n’est pas de percer ou de démarrer, c’est de rester pertinent sur la durée. Je savais que malgré mes bons résultats sur cette année 2018, il allait falloir que ça tienne la distance. Souvent, le plus difficile à gérer dans des carrières sportives, c’est l’usure, encore plus dans des sports d’endurance.
Ces résultats-là, ils m’ont permis de me lancer, de gagner en médiatisation, de montrer de quoi j’étais capable. Mais je ne me suis jamais dit que ma carrière était faite. Ce n’était que le début, ça amorçait beaucoup de choses et c’est à ce moment qu’il fallait être encore plus vigilant. Ce n’est pas quand on est challenger qu’il faut se méfier, c’est quand on se met à nous attendre.

Tu as, par la suite, confirmé tes bons résultats. Tu es montée sur plusieurs podiums, d’autres Ironman, tu es devenue championne de France et vice-championne du monde de triathlon longue distance en 2021… Mais un de tes objectifs phares, c’est l’intégration au top 10 mondial féminin de l’Ironman…
C’est ça, réussir un top 10 voire un top 5 aux championnats du monde d’Hawaï ! C’est un résultat qui a clairement beaucoup de valeur, c’est un objectif qui me reste en tête.
Justement, où est-ce que tu te situes par rapport à cet objectif ? Tu es satisfaite de ta progression, tu aimerais que ça aille plus vite… ?
Ça fait sept ans que je suis professionnelle et j’ai pu voir que j’ai beaucoup évolué dans mes compétences, j’ai beaucoup progressé. Et le triathlon a également énormément évolué. J’ai réussi à suivre la vague et à progresser, c’est déjà pas mal !
Depuis trois, quatre ans, les évolutions sont vraiment très rapides, mais en France, on est à la traîne sur le triathlon. On est en retard en termes de connaissances, de moyens, d’infrastructures, d’accès…
En longue distance, on n’a pas de structures, on doit tout faire tout seul avec très peu de moyens. Forcément, on prend du retard. Pour moi, cette situation est assez difficile à vivre. Je suis une compétitrice, j’ai les qualités pour faire partie des toutes meilleures mondiales mais je me sens un peu limitée.
Et, à ça, s’ajoutent les aléas classiques d’une carrière sportive, les blessures, les doutes… J’aimerais que ça aille plus vite, mais je trouve que je ne m’en sors pas trop mal compte tenu de toutes ces circonstances !

Tu ressens vraiment le désintérêt des structures et des instances pour les triathlètes ?
Complétement. On est un sport individuel, non collectif, non olympique… Je dois faire ma promo pour mon compte, mais toute seule, je ne pèse pas autant qu’une équipe de foot, qu’un club de rugby…
Concrètement, ça veut dire que je m’entraîne sur les horaires publics dans la piscine, je vais courir où je peux, je roule sur les routes avec les voitures comme je peux… On se débrouille, en fait !
Ma façon d’aborder mon sport est professionnelle, mais en termes d’infrastructures et de moyens, c’est loin de l’être.
Pour faire mes entraînements de natation, je bataille avec la mamie en palmes qui est dans la même ligne que moi et qui ne veut pas me laisser passer. On en est encore là !
Financièrement, comment ça se passe pour toi depuis ton passage en pro ?
Les deux sources de revenus d’un triathlète professionnel sont les primes de courses, très aléatoires selon ses résultats, et les sponsors. Ces derniers vont fournir du matériel, de l’argent, les deux… Ça dépend.
Pour trouver des sponsors, il faut être médiatisé, présent sur les réseaux sociaux, savoir communiquer, répondre à leurs attentes… Déjà, c’est compliqué pour certains, tout le monde n’est pas doué là-dedans. Une fois de plus, je suis très contente de ne pas avoir lâché les études, ça m’aide aujourd’hui à faire mon bonhomme de chemin un peu plus rapidement.
C’est moi qui vais générer mon revenu avec mes contacts et partenariats, sinon, il n’y a pas d’autres soutiens. Je n’ai rien d’autre que ce que je construis.
D’une année sur l’autre, je ne sais pas trop si je vais devoir me serrer la ceinture ou non… Il n’y a pas de pérennité. Tous les ans, j’ai l’impression que j’ai tout à reconstruire.

Est-ce que tu es tout de même positive sur l’avenir, est-ce que tu penses que le triathlon peut évoluer en France pour que tu sortes de ce schéma délicat, ou tu n’en vois pas le bout ?
Je pense que l’argent est le nerf de la guerre. Si j’arrive à faire de très gros résultats, de plus gros chèques vont suivre et ça simplifierait pas mal de choses. Tout repose sur mes épaules, ça fait partie du job !
Après, forcément, ceux qui ont plus de moyens au début vont pouvoir les utiliser à bon escient et avoir plus de chances de réussir… C’est plus compliqué pour beaucoup d’autres. Mais sur une ou deux courses, tout peut s’inverser !
C’est largement faisable et c’est même ça qui est grisant. Il me suffit de faire de beaux résultats pour que ça change. Et encore, je ne suis pas à plaindre, jusque-là, j’ai bien géré ce que je fais.
Disons que, pour le moment, on est toujours dans l’optimisation maximale plutôt que dans une certaine légèreté avec moins de charge mentale sur ce point.
Le fait d’être une femme dans le triathlon, ça t’a déjà posé des problèmes ? Des propos blessants, une médiatisation moins forte, un intérêt moindre des sponsors…
Je trouve que le triathlon est un sport moderne, dans le sens où sur les plus grandes courses, les primes sont équitables entre hommes et femmes. Ça, dans d’autres sports, ce n’est pas le cas. Et on fait également les mêmes distances que les hommes.
Après, quand j’étais amateur, sur des courses, je me suis déjà pris des remarques, ou bien le garçon ne voulait pas me laisser le dépasser… C’est assez lambda, j’en rigolais beaucoup.
Depuis que je suis pro, ça a quand même pas mal changé. Il y a du respect pour ceux qui en font leur métier.
Pour autant, après sept ans de pratique au niveau professionnel, je me rends compte qu’il y a encore beaucoup d’évolutions à venir. En tant que femmes, on est souvent minimisées dans nos résultats, dans notre médiatisation… On a moins de valeur !
Et ça va se traduire avec des contrats qui sont plus difficiles à négocier à la hausse, ou même sur un apport financier. On peut avoir également des attentes plus exigeantes pour une femme que pour un homme, avec certaines clauses ou encore aucune différenciations en fonction du sexe.
Ainsi, aucun de mes contrats actuels ne contient une clause maternité. Ce qui est assez délicat, c’est que l’on prône l’équité alors qu’un athlète masculin ne fonctionne pas comme une athlète féminine.
On a encore du mal à valoriser la femme telle qu’elle est, avec ce qu’elle peut apporter. On la compare tout le temps à l’homme, ce qui est un peu dégradant et fatiguant à vivre au quotidien.

Quand tu te projettes sur les années à venir, est-ce que tu es optimiste ?
Je donne toujours le meilleur de moi-même, j’essaye d’être un maximum positive. Et je n’attends pas un résultat pour mettre en place certaines choses. Par exemple, cette année, je me suis engagée avec l’association « La Maison du Sport au Féminin » qui est basée à Toulouse.
Bien sûr qu’un gros résultat aide à la médiatisation, mais ça n’apporte pas plus de valeur à une personne pour autant.
Même si j’ai souvent la tête dans le guidon, quand je prends un peu de recul, je me rends compte que la vie que j’ai est hyper riche ! Toutes les évolutions que l’on peut faire, les analyses, j’essaye déjà d’y contribuer à mon échelle.
Ce que je peux mettre à profit pour aider les jeunes générations, les femmes, le club de triathlon que j’ai monté, Lureau Sport Training, je le fais déjà.
Avec tout ça, je suis super positive concernant mon avenir. Mes engagements me donnent plein d’idées pour la suite, il y a encore beaucoup de choses à tenter !
La YOTTA XP 2023 a lieu dans moins d’un mois… L’année dernière, tu as fini deuxième. Cette fois, comment tu abordes la course ?
J’ai eu un accident de vélo récemment, je me remets encore de ma fracture de la clavicule. Alors ,cette année, je serai à la YOTTA pour me faire plaisir, en espérant pouvoir courir un peu, mais sans recherche de performance.
Et à part une bonne reprise lors de la YOTTA, qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour les mois et années à venir ?
Une foule de rencontres enrichissantes et un plein épanouissement dans ma carrière sportive !